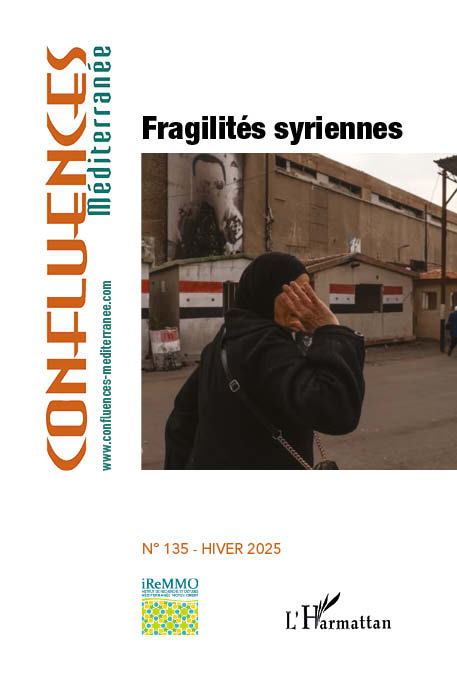Un an après le 7 octobre, Israël est déterminé à vouloir anéantir le Hezbollah tandis que ce dernier n’a pas l’intention de se rendre. L’Iran rentre dans cette escalade dans un devoir d’assistance à son principal allié régional et est soucieux de restaurer sa crédibilité et sa dissuasion. Il semble pris dans le dilemme consistant à participer à l’escalade tout en essayant d’éviter le déclenchement d’un conflit ouvert avec Israël. Les pays occidentaux, les États-Unis en tête, sont incapables ou non-désireux de raisonner l’État hébreu et continuent de le soutenir militairement, malgré de relatifs repositionnements diplomatiques. Les pays arabes, l’Arabie saoudite en tête, sont dans une position d’attentisme.
Le Liban, prisonnier d’un Hezbollah affaibli et d’une classe politique divisée
La mort de Hassan Nasrallah est une onde de choc puisque le Sayed était le visage de l’axe de la résistance et il paraît, par bien des aspects, irremplaçable.
La branche militaire du parti sort affaibli de l’offensive israélienne, Tsahal ayant récemment démontré sa nette supériorité informationnelle et opérationnelle. Plusieurs mythes se sont effondrés: celui de l’équilibre de la terreur dont se vantait le Hezbollah; celui de la toute-puissance d’un mouvement qui était devenu une armée régionale; celui de l’invincibilité de Nasrallah; et celui de l’unité des fronts si cher à l’Iran.
Le Hezbollah est au pied du mur et semble assez seul, pour l’instant. D’une part, son parrain iranien cherche davantage à rétablir sa crédibilité plutôt que de soutenir son allié. En effet, l’attaque balistique iranienne n’a pas visé les positions de l’armée israélienne menaçant directement le Liban et le Hezbollah. D’autre part, ni les Houthis, ni les milices irakiennes et encore moins le régime Assad ne sont venus en aide de manière conséquente au Hezbollah, pour l’instant.
Toutefois, malgré les lourdes pertes enregistrées ces dernières semaines, le parti chiite conserverait en réserve un arsenal massif de munitions, composé de roquettes, de drones et de missiles antichars ainsi que de dizaines de milliers de combattants. Il est également difficile de se prononcer sur les conséquences de la disparition d’une partie de ses dirigeants sur le commandement du parti.
Le Hezbollah est plus à même de résister dans le cas d’une invasion du Liban car il «aurait la capacité de mener des opérations de guérillas et d’enliser les forces israéliennes dans une guerre d’usure», explique le général libanais Khalil Hélou. Mais il sera soumis au feu vert de Téhéran avant de prendre quelque décision importante, notamment sur l’emploi de ses missiles les plus sophistiqués.
Par ailleurs, l’aile politique du parti laisse entendre une certaine ouverture pour dissocier les fronts palestinien et libanais: Naïm Kassem, qui vient d’être nommé Secrétaire général, affirme que «l’important, c’est qu’un cessez-le-feu soit atteint», le clerc n’ayant pas fait de lien entre le Liban et Gaza.
Concernant la classe politique libanaise, l’avancée la plus notable dans la tentative d’établir un front commun face aux attaques israéliennes vient du communiqué commun de Najib Mikati (Premier ministre sortant), de Nabih Berry (président de la Chambre et chef du mouvement chiite Amal) et de Walid Joumblatt (leader druze) qui rappelle l’adhésion du Liban au projet de cessez-le-feu porté par les États-Unis et la France à l’Assemblée générale de l’ONU et renouvelant «l’engagement du gouvernement à appliquer la résolution 1701». Les trois zaims ont maintenu cette position au cours d’entretiens individuels[1] donnés en octobre.
Certains partis chrétiens ont dénoncé leur absence de ce communiqué, mais étant fragmentés en plusieurs groupes, ils ne parviennent à trouver une figure consensuelle pour les représenter. Samir Geagea, chef des Forces libanaises, fustigeait Mikati et Berry en affirmant qu’ils ne «souhaitent pas demander au Hezbollah de se désarmer». Selon lui, il faut mettre en œuvre l’ensemble des résolutions du Conseil de sécurité, notamment la 1559 et la 1701. Gebran Bassil, qui a remplacé Michel Aoun à la tête du Courant Patriotique Libre, anciennement allié du Hezbollah, affirme que son parti n’est plus «en situation d’alliance» avec le parti de Dieu, puisque sa politique «favorise d’autres pays au détriment du Liban».
Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce sont les chefs des communautés religieuses qui sont les seuls à être parvenus à faire un relatif front commun lors du sommet spirituel de Bkerké, plaidant pour un cessez-le-feu immédiat et évoquant l’application de la résolution 1701 «dans son intégralité» dans leur communiqué conjoint.
Le Liban, terrain d’affrontement entre deux visions du Moyen-Orient
La position iranienne révèle un dilemme pour le régime: il s’agit de trouver un moyen de riposter sans déclencher une guerre ouverte avec Israël. Le régime semble avoir tranché pour la première option, en lançant sa plus grosse attaque directe sur Israël de son histoire. L’Iran reste ambigu sur sa volonté de séparer les deux fronts : si le fait que le Hezbollah n’ait pas participé à la riposte laisse penser que le parrain iranien sépare les deux questions, ce n’est pas ce que son ministre des Affaires étrangères a déclaré récemment au Liban. En réalité, il s’agit surtout pour l’Iran de restaurer sa crédibilité plutôt que de se poser en défenseur du parti chiite.
Le conflit actuel remet en cause l’architecture de sécurité que l’Iran a constituée depuis 40 ans. L’axe de la résistance est un cordon sanitaire permettant à Téhéran de maintenir un degré de dissuasion face à Israël, mais sa durabilité est désormais en jeu. Si certains perçoivent cet axe comme un bloc homogène, il convient de nuancer cette vision en étudiant l’interaction entre les liens mécanique (alignement des intérêts) et organique (soumission des milices à l’agenda iranien) qu’entretiennent ses membres, comme le note Adel Bakawan. Si les parties syriennes et irakiennes de l’axe se sont peu impliquées, c’est qu’elles priorisent des enjeux nationaux, tels que la souveraineté de Bachar el-Assad sur son territoire et les élections législatives en Irak de l’automne 2025. Quant aux Houthis, s’ils se sont alignés dès le 7-octobre via des opérations en Mer Rouge, ils n’ont pas intensifié leurs attaques à la suite aux revers subis par le Hezbollah.
De son côté, si Israël disposait de plusieurs moyens pour répondre à l’attaque iranienne (assassinats ciblés contre des cadres iraniens ou de ses alliés, frappes contre des sites nucléaires ou des infrastructures énergétiques), l’Etat hébreu a finalement opté pour une attaque importante sur le sol iranien mais qui ne saurait constituer une escalade majeure dans le conflit. Nonobstant, au même moment, ce sont des frappes intensives et régulières sur le Liban qui se poursuivent. L’état-major israélien s’est déjà ouvertement prononcé en faveur d’une invasion. L’ambition affichée est double : forcer la milice chiite à arrêter de tirer des roquettes pour permettre le retour des habitants du Nord d’Israël; et créer une zone tampon en contraignant le parti de Dieu au-dessus du fleuve Litani.
Ainsi, Israël cherche à capitaliser sur sa position de force pour consolider sa sécurité. Plutôt que d’emprunter la voie diplomatique, perçue comme trop exigeante en termes de concessions (territoriales, statut des Palestiniens), le gouvernement israélien privilégie une approche sécuritaire à court terme. Cette stratégie de «tondre la pelouse», consistant à affaiblir les groupes perçus comme dangereux, sans s’attaquer aux conditions qui les génèrent, est la même que celle qui s’opère à Gaza depuis un an. Il a drastiquement réduit les capacités du Hamas, qui existe toujours, et a détruit la majorité des infrastructures civiles sans penser à une solution pour les populations déplacées – si ce n’est celle du départ forcé.
Ce sont les lignes rouges des États-Unis qui semblent être les seules capables de limiter Israël dans sa riposte. Les Américains, malgré leur appel aux côtés de la France pour un cessez-le-feu en début octobre, fournissent un soutien inconditionnel à Israël, qui s’explique par les intérêts communs que les deux pays partagent dans la région, mais aussi par la politique d’influence de l’État hébreu au sein du système politique américain, à travers l’organisation Aipac, comme le rappelle notamment Gérard Araud dans ses mémoires diplomatiques.
Empêtrée dans une campagne présidentielle disputée, l’administration Biden n’est pas en position de force pour imposer des lignes rouges à Netanyahou, qui joue la montre. Elle est cependant parvenue, probablement grâce à la pression des États arabes qui s’opposent à un embrasement général de la région, à coordonner la riposte israélienne de la nuit du 25 au 26 octobre, qui a été mesurée par rapport aux discours bellicistes des responsables israéliens. Cependant, les États-Unis voient d’un bon œil l’affaiblissement de l’Iran et de ses alliés au profit d’un Moyen-Orient repensé par Israël, suivant les fondations posées par les Accords d’Abraham.
Impuissantes, la France et l’Europe assistent à la recomposition du Moyen-Orient
La portée du discours des pays européens semble n’avoir aucun impact, en dépit du fait que ces États demeurent des puissances économiques et militaires. Leur image s’est dégradée au gré d’interventions échouées ou avortées (Irak, Libye, Syrie), permettant à leurs compétiteurs de dénoncer un deux poids, deux mesures, notamment à la lumière de leur soutien inconditionnel à l’Ukraine au nom du droit international. Ce positionnement hypocrite sape les fondements de l’ordre international que le Vieux Continent prétend défendre.
La France fut incapable de créer un État libanais laïc, respectant les communautés mais n’en faisant pas la pierre angulaire du système politique. En consacrant le rôle des communautés et celui de leurs chefs, la France a favorisé l’émergence d’un État qui ne sert qu’à répartir le pouvoir et les richesses du pays entre les communautés, selon le rapport de force du moment. Aujourd’hui, le Liban est incapable d’avoir une position unie par rapport à Israël et son agression: certains ripostent, d’autres demandent un cessez-le-feu et certains se taisent.
En prenant le contrôle de la Palestine mandataire, le Royaume-Uni dut faire face à un dilemme insoluble. Pendant la Première guerre mondiale, il avait à la fois promis aux Juifs et aux Arabes qu’il les soutiendrait dans la création d’un État sur un même territoire. Cette politique aboutit à une première islamisation de la question palestinienne tout en favorisant l’immigration juive et contribua à la polarisation des positions de chacun, résultant sur la Nakba palestinienne et le déclenchement du conflit israélo-arabe en 1948.
La France comme le Royaume-Uni poursuivaient leurs intérêts lors de la mise en œuvre de ces politiques, comme le font les États-Unis, Israël ou l’Iran aujourd’hui. Cependant, est-ce dans l’intérêt des Européens que d’avoir un Proche-Orient embrasé? L’Union européenne et ses États membres sont les principaux bailleurs de fonds de la région et considèrent la pression migratoire venant de Méditerranée comme un défi quasi-existentiel: quels retours sur investissement si les infrastructures financées par l’UE sont rasées par les bombardements ? Comment entraver des vagues d’immigration dans un Proche-Orient rempli de réfugiés politiques et économiques?
Au-delà des considérations réalistes, la guerre au Proche-Orient voit s’effriter à nouveau les principes du droit international et humanitaire, qui tentent d’encadrer les relations internationales. Comment les pays européens peuvent-ils prétendre défendre cet ordre si rien n’est fait pour qu’il soit respecté?
Ces questionnements invitent à une réflexion plus large sur l’autonomie stratégique des pays européens. Leur approche face à la manière dont est menée la guerre au Proche-Orient se cantonne, d’une part, à de grandes déclarations, souvent contradictoires d’une semaine à l’autre, et rarement suivies de mesures concrètes et, d’autre part, à un soutien humanitaire, nécessaire, mais qui ne saurait s’attaquer aux racines du problème. Les Européens souffrent d’un vide dans leur pensée géopolitique.
Les pays arabes l’ont compris: ils ne comptent ni sur la France, ni sur le Royaume-Uni, ni sur l’Allemagne pour espérer un cessez-le-feu. Israël l’a compris: Netanyahou n’en a que faire des propos d’Emmanuel Macron sur un potentiel embargo sur les armes fournies à l’État hébreu. Ce sont les États-Unis qui mènent encore le bal : ils coordonnent la réponse israélienne à l’attaque iranienne et s’engagent en ce moment dans des négociations de Tel Aviv à Doha afin de parvenir à un cessez-le-feu.
Pour retrouver une certaine crédibilité, il faut d’abord avoir les idées claires. Les Européens ont tout intérêt à définir leurs intérêts stratégiques au Moyen-Orient. La stabilité de la région, à la fois pour les opportunités d’investissements qu’elle offre et pour éviter une nouvelle crise migratoire, pourrait constituer un pilier. Mais il faut également que ces idées claires soient suivies par des mesures concrètes, qu’elles soient incitatives ou coercitives. L’arsenal militaire de la France, les capacités de sanctions économiques de l’Union européenne sont des leviers pour donner du crédit à ces (re)positionnements stratégiques.
Comme l’a affirmé le président Macron lors de la conférence de soutien au Liban le 24 octobre, «On parle beaucoup de civilisations qu’il faut défendre – mais je ne suis pas sûr qu’on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie. Je suis sûr d’une chose, c’est que la possibilité d’Une civilisation se joue au Liban.» Reste à savoir si ces paroles se matérialiseront en actes.
De Victor Jardin et Owen Steketee