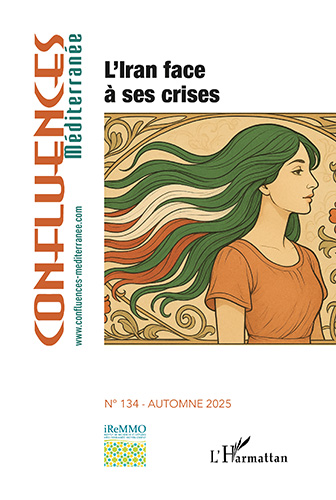En frappant la direction politique du Hamas à Doha, Israël a envoyé un message clair: bravant les efforts américains pour arracher un énième – et ultime – accord, le gouvernement de Benyamin Netanyahou privilégie l’escalade militaire. Cet épisode incarne l’hubris d’un gouvernement enlisé depuis plus de 700 jours dans une guerre sans perspective de sortie négociée, si ce n’est par la promesse d’une victoire sanglante et totale faisant fi du droit international.
La décision de bombarder un des principaux pays médiateurs du conflit, à plus forte raison un allié majeur des États-Unis dans la région, a tout d’une fuite en avant. Celle-ci doit être interprétée à l’aune des pressions internationales – limitées certes – qui poussent pour un accord négocié et l’arrêt de la colonisation en Cisjordanie. Elle n’est également pas éloignée des fractures qui s’accentuent au sein de la société israélienne concernant les buts de guerre.
Confrontés aux effets de l’enlisement du conflit, tant en interne qu’à l’extérieur, les dirigeants israéliens répondent par la volonté d’imposer un statu quo dans l’espoir de rassurer leur opinion publique et contenir les pressions diplomatiques. Une stratégie de surenchère qui, en plus d’accentuer leur isolement, n’offre que peu d’horizon souhaitable.
Enterrer les négociations
Les dirigeants du Hamas ciblés par Israël étaient réunis à Doha, capitale du Qatar, pour discuter d’une proposition de cessez-le-feu du président américain Donald Trump. Cette dernière, qualifiée de « dernière chance » par le locataire de la Maison blanche, comprenait la libération de tous les otages israéliens, le retour d’un nombre convenu de prisonniers palestiniens et le désarmement du mouvement. Si Tel-Aviv, par la voix de son ministre des Affaires étrangères Gideon Saar, s’était déclaré favorable à un tel accord, le Hamas, quant à lui, a salué l’initiative tout en exprimant son désir de voir l’accord s’accompagner d’engagements pour « éviter une répétition des expériences passées où des accords ont été conclus, puis rejetés ou annulés »[1].
Cette déclaration répondait à un autre projet de trêve temporaire porté par le Qatar et l’Égypte et soutenu par les États-Unis. Basé sur les même modalités – à l’exception du désarmement – il avait été accepté par le Hamas le 18 août. Israël n’avait alors pas réagi à la proposition, préférant poursuivre ses préparatifs en vue de lancer son opération «Chariots de Gidéon 2» pour prendre d’assaut la ville de Gaza. Contrairement aux demandes du Hamas d’entamer son processus de désarmement après la reconnaissance de l’État palestinien et la nomination d’un organisme indépendant composé de Palestiniens pour gouverner Gaza, Tel-Aviv pose comme condition la démilitarisation du groupe, le contrôle sécuritaire de la bande de Gaza et l’établissement d’une administration civile qui ne «menace pas» Israël.
L’opération du 9 septembre ne s’inscrit en rien dans une logique de négociation, mais a tout d’une volonté d’imposer ces conditions de sortie de guerre. Elle visait à éliminer les principaux dirigeants du Hamas basés au Qatar afin de renforcer l’étau sur ceux présents dans Gaza, soumis à une intense pression militaire israélienne. À cet égard, elle n’a pas rempli ses objectifs : parmi les six personnes tuées dans les frappes, la plupart sont des cadres intermédiaires et des gardes du corps. Quant à Khalil Al-Hayya, principale cible de ce bombardement et l’une des figures centrales du mouvement[2] depuis la mort d’Ismail Haniyeh et de Yahya Sinwar l’année dernière, il aurait survécu. Son objectif parallèle, éloigner la perspective d’une négociation semble quant à lui atteint. De l’aveu même du porte-parole du ministère des affaires étrangères qatari la médiation est compromise: «tout autre considération politique (que la préservation de sa sécurité nationale) passe au second plan»[3].
Des gains diplomatiques incertains
Sur le plan diplomatique, ses gains sont également à relativiser. Selon le site d’information proche de la nouvelle administration américaine Axios, Donald Trump n’aurait pas été consulté au préalable, mais seulement « informé » au moment où la frappe était imminente[4]. Ces informations méritent d’être maniées avec précaution, puisqu’il est peu probable que l’opération ait pu se dérouler sans le blanc-seing, au moins implicite, de Washington. Toutefois, une telle initiative personnelle de Benyamin Netanyahou – dont il a lui-même déclaré qu’il en assumait « l’entière responsabilité »[5] – pourrait fragiliser la confiance entre les États-Unis et Israël, d’autant plus qu’elle visait un partenaire crucial de Washington dans la région. Médiateur sur de multiples dossiers régionaux, le Qatar est également le pays qui accueille la plus grande installation militaire américaine de la région, la base aérienne d’Al-Udeid, qui permet à son Commandement central (Centcom) de coordonner les opérations militaires dans la zone.
L’attaque a suscité de vives réactions de la part de l’ensemble des pays du Golfe, affirmant leur soutien au voisin qatarien. Même les Émirats arabes unis, pourtant fer de lance de la normalisation avec Israël depuis la signature des accords d’Abraham en 2020, ont été le premier pays du Golfe à se rendre à Doha[6], qualifiant l’action israélienne de «traîtresse»[7]. Au lendemain de l’attaque, la fédération a interdit aux industries de défense israéliennes de participer au salon aéronautique de Dubaï prévu en novembre prochain[8].
L’offensive israélienne est d’autant plus traumatisante que, pour la plupart des monarchies du Golfe – à l’instar du Qatar pour qui la médiation est un engagement inscrit dans sa Constitution –, la capacité à jouer un rôle de pivot diplomatique représente un enjeu géostratégique central. Qualifiée de «terrorisme d’État» par Doha[9], elle porte atteinte à leur statut de pays médiateur pourrait les conduire à une réévaluation stratégique de leurs relations à la fois vis-à-vis d’Israël et des États-Unis.
L’attitude israélienne ne sera donc pas sans conséquences pour l’image de Washington dans la région, notamment pour les pays du Golfe qui redoutent l’escalade régionale et comptent sur les États-Unis pour garantir cette sécurité. Déjà en juin 2025, le soutien puis la participation de la Maison blanche à l’attaque israélienne de grande ampleur sur l’Iran n’avait pas manqué de susciter le scepticisme des monarchies. Un appui total de Washington à la logique d’escalade promue par Israël pourrait bien à son tour entraîner une érosion de la crédibilité des États-Unis dans la région[10]. À cet égard, le soutien inconditionnel américain devrait être réexaminé à l’aune de ses coûts. En effet, la récente tournée dans la région de Donald Trump en mai dernier a prouvé à quel point le locataire de la Maison blanche souhaite engranger des dividendes économiques de sa relation avec les pays du Golfe. De même, à peine plus d’un avant les élections de mi-mandat, son soutien à la politique belliciste de Tel-Aviv pourrait avoir des répercussions sur sa base électorale[11].
En entrainant Washington dans sa logique de surenchère le gouvernement Netanyahou prend le risque d’affaiblir son propre parapluie sécuritaire : il scie la branche sur laquelle il se trouve. Depuis le 7 octobre 2023, le Qatar est le cinquième pays directement visé par des bombardements israéliens. Et le ciblage d’une flottille humanitaire au large de Tunis dans la nuit du 8 au 9 septembre semble confirmer sa volonté d’étendre son action à l’échelle régionale, sans crainte des répercutions. Pourtant, cet hubris prive Israël d’un de ses principaux objectifs : se bâtir un environnement régional de sécurité, autrefois facilité par l’influence et le soutien des États-Unis, moteur de la dynamique des Accords d’Abraham. Cet horizon s’éloigne pour Israël, si ce n’est, pense-t-il, en l’imposant par les armes.
La colonisation et le statu quo imposé
La fuite en avant israélienne s’inscrit également dans une stratégie plus large d’imposer un statu quo sur la question palestinienne face aux offensives diplomatiques. En effet, de nombreuses chancelleries occidentales ont annoncé qu’elles reconnaitraient l’État palestinien à l’occasion de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, le 22 septembre prochain. L’initiative, menée par la France et l’Arabie saoudite, regroupe également la Grande-Bretagne, la Belgique, le Canada et l’Australie. Dans ce cadre, Paris et Riyad souhaitent convaincre les États membres de l’ONU de se rallier à une déclaration posant les principes d’un règlement du conflit par la création d’un État palestinien.
Mais, sur le terrain, l’initiative pourrait venir se fracasser sur la réalité. Alors que l’état-major israélien poursuit son opération militaire dans la ville de Gaza visant à prendre le contrôle de l’ensemble de l’enclave, la colonisation en Cisjordanie s’accélère. Le 23 juillet dernier, la Knesset a adopté une motion symbolique appelant à la souveraineté totale d’Israël dans les territoires occupés, accordant au gouvernement une enveloppe de plus de 200 millions d’euros pour la construction d’infrastructures. Le mois suivant a été lancé le projet d’occupation de la zone dite «E1» (Est 1), située à l’est de Jérusalem[12]. Porté par le ministre des Finances d’extrême droite, Benzalel Smotrich, il permettrait d’étendre l’emprise des colonies autour de la capitale de jure de l’Autorité Palestinienne et couperait la Cisjordanie en deux, oblitérant ainsi tout espoir d’ériger un État palestinien viable, déjà mité par la colonisation.
L’administration Trump joue un rôle déterminant à cet égard. Alors que les précédents gouvernements étaient opposés à ce projet qui date des années 1990, une première mouture ayant même été rejetée sous Joe Biden, Washington a désormais levé son veto. De même, en réponse à l’initiative diplomatique franco-saoudienne, le département d’État américain a annoncé le 29 août qu’il allait refuser et révoquer les visas des membres des organisations qui représenteront les Palestiniens à l’Assemblée générale de l’ONU[13].
Vers une impasse politique et morale
Enfin, l’opération israélienne répond à des considérations de politique intérieure. Près de deux ans après le début de l’offensive, l’enlisement a imprimé ses effets sur la société israélienne et la question des otages à Gaza est devenue explosive. Selon certains sondages, près de 80 % des Israéliens sont favorables à la fin de la guerre en échange des otages détenus à Gaza[14]. De même, la fatigue du conflit et l’absence de résultats tangibles impactent l’institution militaire. Le 2 septembre, en vue de pérenniser l’offensive sur la ville de Gaza, l’armée a lancé son plus grand appel à la mobilisation avec environ 60 000 réservistes mobilisés en plusieurs vagues. Selon les médias israéliens, de nombreux appelés auraient demandé des exemptions[15].
Ainsi, face aux effets potentiellement perturbateurs d’une fatigue de guerre, le gouvernement choisit la fuite en avant, tentant de maximiser ses gains sur le terrain, avant que la situation ne l’amène à accepter un cessez-le-feu. Malgré les contestations en interne, cette stratégie repose sur l’acceptation de la part de la quasi-totalité de la population d’un paradigme dominant: celui de la poursuite de l’occupation, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. Tant au niveau de la classe politique que parmi la société civile, la critique de la conduite de guerre de Benyamin Netanyahou relève davantage d’une différence de degré, non de nature[16].
Les sondages sont à cet égard éclairants. Selon l’Institut israélien de la démocratie, alors que seul 39% des citoyens juifs interrogés ne pensent pas que les opérations à Gaza permettront le retour des otages, 76,5% estiment qu’Israël ne devrait pas du tout prendre en compte les souffrances de la population civile[17]. Pire, d’après un sondage du journal Haaretz, 82 % des personnes interrogées sont favorables à l’expulsion des habitants de l’enclave[18].
Caractérisée par les bombardements à Doha, la logique d’escalade de l’administration Netanyahou comporte de nombreux risques. Ils sont à la fois politiques, géostratégiques et sécuritaires. La poursuite du drame humanitaire à Gaza provoquera immanquablement de nouvelles violences comme l’attentat du 9 septembre dernier à Jérusalem-Est qui a fait 6 victimes[19]. Sans la reconnaissance de l’État palestinien, aucun nouvel accord d’Abraham ne sauvera l’inexorable isolement d’Israël sur la scène régionale. Et, face à l’action du gouvernement israélien, même le soutien inconditionnel des États-Unis peut se fragiliser et, avec lui, son parapluie diplomatique et sécuritaire.
Le refus manifeste de se diriger vers une sortie négociée met la société israélienne face à la plus grande de ses contradictions : préserver sa sécurité ou poursuivre sa politique belliciste et coloniale. En choisissant l’escalade, Netanyahou pense imposer un statu quo à même de satisfaire son opinion publique et réfréner les initiatives diplomatiques : une résolution du conflit par la force et une situation sur le terrain qui réduirait toute reconnaissance d’un État palestinien à un geste diplomatique sans lendemain, faute de territoire pour l’incarner.
Reste à présent à savoir combien de temps le gouvernement israélien, ses citoyens et ses partenaires extérieurs pourront entretenir cet hubris avant de se confronter à l’absence d’horizon politique, sécuritaire, stratégique et moral qu’il recouvre.
[1] https://thecradle.co/articles/us-israel-issue-final-warning-to-hamas-as-new-ceasefire-deal-takes-shape
[2] https://www.lorientlejour.com/article/1477007/infographies-les-dirigeants-du-hamas-tues-leurs-successeurs-et-la-structure-du-mouvement-depuis-le-7-octobre.html
[3] https://www.lemonde.fr/international/article/2025/09/11/attaque-d-israel-au-qatar-ni-plus-ni-moins-que-du-terrorisme-d-etat-selon-la-diplomatie-de-l-emirat_6640435_3210.html
[4] https://www.axios.com/2025/09/09/israel-attack-qatar-hamas-trump-reaction
[5] https://www.lorientlejour.com/article/1476692/attaque-au-qatar-netanyahu-affirme-quisrael-a-agi-de-maniere-independante-.html
[6] https://www.lemonde.fr/international/article/2025/09/11/l-attaque-israelienne-au-qatar-un-reveil-brutal-pour-les-pays-du-golfe_6640409_3210.html
[7] https://www.lorientlejour.com/article/1476746/les-frappes-israeliennes-dechainent-les-condamnations-et-irritent-donald-trump.html
[8] https://www.al-monitor.com/originals/2025/09/uae-president-visits-qatar-bans-israel-dubai-airshow-after-doha-strikes
[9] https://www.lemonde.fr/international/article/2025/09/11/attaque-d-israel-au-qatar-ni-plus-ni-moins-que-du-terrorisme-d-etat-selon-la-diplomatie-de-l-emirat_6640435_3210.html
[10] https://agsi.org/analysis/israel-strikes-hamas-in-qatar/
[11] https://orientxxi.info/magazine/etats-unis-israel-au-coeur-des-divisions-de-maga,8483
[12] https://legrandcontinent.eu/fr/2025/08/21/projet-e1-le-plan-smotrich-pour-enterrer-etat-palestinien/
[13] https://www.lemonde.fr/international/article/2025/08/29/les-etats-unis-refusent-l-octroi-de-visas-a-des-responsables-palestiniens-avant-l-assemblee-generale-de-l-onu_6637439_3210.html
[14] https://www.wsj.com/world/middle-east/israelis-hold-nationwide-protests-and-strike-to-end-the-gaza-war-db3854e7?mod=article_inline
[15] https://www.timesofisrael.com/tens-of-thousands-of-reservists-drafted-ahead-of-gaza-city-takeover-but-turnout-down/
[16] https://orientxxi.info/magazine/l-illusion-d-une-opposition-democratique-en-israel,8454
[17] https://en.idi.org.il/articles/59568
[18] https://www.haaretz.com/israel-news/2025-05-28/ty-article-magazine/.premium/yes-to-transfer-82-of-jewish-israelis-back-expelling-gazans/00000197-12a4-df22-a9d7-9ef6af930000
[19] https://www.lemonde.fr/guerre-au-proche-orient/article/2025/09/08/jerusalem-au-moins-cinq-morts-dans-une-attaque-a-l-arme-a-feu-la-police-dit-avoir-neutralise-deux-terroristes_6639952_6325529.html