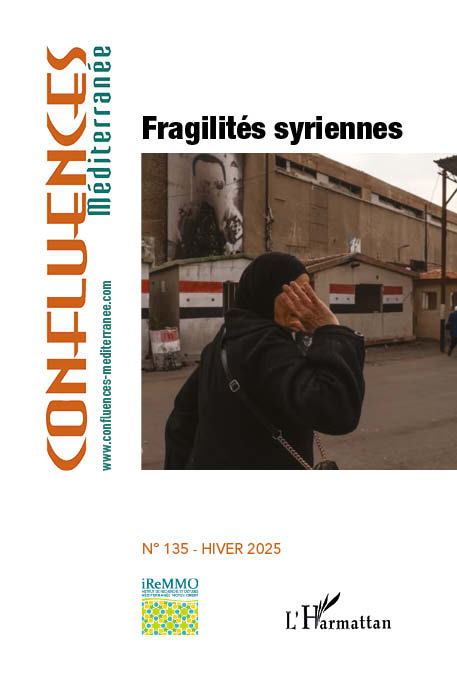État récent à l’échelle régionale, né en 1921 de la dislocation de l’Empire ottoman et des recompositions territoriales du mandat britannique, le royaume hachémite s’est construit sur un territoire dépourvu de véritable homogénéité historique, linguistique ou ethnique. Sa population, estimée alors à environ deux cent mille habitants, regroupait des tribus bédouines, des communautés circassiennes et tchétchènes ainsi qu’une minorité chrétienne significative. Amman, future capitale, n’était qu’une petite agglomération sans dialecte propre et majoritairement peuplée de familles non arabes.
Dans ce contexte, la construction d’une identité nationale jordanienne relevait moins d’un simple processus politico-historique que d’un processus identitaire performatif: un récit d’État, une fiction créatrice[1], visant à tisser des liens symboliques entre des populations hétérogènes et à donner corps à une communauté encore à inventer. Justement, le pouvoir a progressivement façonné une communauté imaginée [2], fondée sur un sentiment d’appartenance commune et une loyauté envers la monarchie. Élaborée par l’État et incarnée par le trône, cette narrative d’unité a servi à la fois d’instrument de cohésion et de mécanisme de légitimation – un processus au sein duquel le nationalisme occupe une place centrale.
Les initiatives gouvernementales, en particulier celles portées par l’armée et les forces de sécurité, ont ainsi servi de piliers à un nationalisme par le haut[3] qui a puisé dans les affiliations tribales afin d’articuler leur fidélité à la loyauté monarchique. Ce nationalisme, ceci-dit, s’est aussi manifesté dans les pratiques ordinaires de la vie sociale: ce nationalisme banal[4] a opéré comme un mécanisme de reproduction quotidienne de la nation, à travers une routine des symboles, des gestes et des expressions communes. En Jordanie, ces marqueurs se donnent à voir dans des champs aussi divers que le sport[5], la langue[6], ou la cuisine[7].
En cherchant à produire une unité singulière à partir de la diversité, ce projet national a révélé les limites de sa performativité: la fiction d’une communauté homogène s’est heurtée à la pluralité des appartenances et aux clivages internes qui traversent la société jordanienne. Ces tensions prennent un relief particulier lorsqu’il s’agit de la population palestinienne, qui constitue une majorité démographique et un enjeu politique central. En effet, depuis 1948, les Palestiniens sont à la fois partis intégrants du tissu social jordanien et figures d’altérité autour desquelles s’est cristallisé le nationalisme transjordanien. Leur présence massive, leur rôle économique et leur exclusion relative du pouvoir ont contribué à façonner un équilibre identitaire fragile, sans cesse renégocié par le régime.
La manière dont l’«altérité palestinienne» a été intégrée au récit national jordanien est particulièrement révélatrice, surtout si l’on considère son évolution historique. L’effort pour assimiler cette identité illustre le double paradoxe d’un « nouvel » État qui cherche à se construire comme une nation tout en demeurant le miroir de ses hétérogénéités.
D’une part, l’identité palestinienne est constitutive de la Jordanie ; d’autre part, la «jordanisation» de cette singularité vise à la fondre dans un récit national unifié. Mais cette unification de surface ne saurait effacer les différences structurelles ni les inégalités imposées, que perpétuent à la fois le façonnage narratif de l’État et ses politiques économiques, sociales et institutionnelles.
Nakba et intégration forcée: le prix de la citoyenneté
L’année 1948 marque un tournant majeur dans l’histoire du royaume hachémite, la Nakba provoquant l’exode de plus de 700000 Palestiniens expulsés de leurs foyers. Parmi eux, près de 70000 trouvent refuge en Transjordanie, alors peuplée d’à peine 440000 habitants indigènes. Ce flux massif impacte profondément les équilibres démographiques et politiques d’un royaume encore jeune.
En 1950, le roi Abdallah Ier décide d’annexer la Cisjordanie, officialisant ainsi l’union des «deux rives du Jourdain». L’objectif affiché est celui d’une unification nationale : construire un seul État, transcendant la distinction entre Palestiniens et Transjordaniens. Pourtant, derrière cette rhétorique unificatrice se dessine un calcul politique plus pragmatique: empêcher l’émergence d’une direction palestinienne autonome susceptible de concurrencer la monarchie, tout en consolidant, à travers l’intégration territoriale, la légitimité du trône hachémite.
Cette refonte de l’identité politique et juridique s’opère à travers l’octroi massif de la nationalité jordanienne : elle est attribuée à 440000 Palestiniens déjà résidents de Cisjordanie, à 280000 réfugiés venus des territoires devenus israéliens, et à ces 70000 autres réfugiés installés en Transjordanie. Cette naturalisation, présentée de nouveau comme un geste d’unité nationale, comporte un prix identitaire élevé. En devenant Jordaniens, les réfugiés palestiniens se voient contraints de renoncer symboliquement à une part essentielle de leur identité palestinienne. Le décret royal du 1ᵉʳ mars 1950 interdit par ailleurs l’usage du terme «Palestine» dans tous les documents officiels, effaçant le pays du langage administratif. La construction de l’unité nationale s’accompagne donc d’un processus d’effacement politique et mémoriel, transformant les Palestiniens en citoyens jordaniens en niant la spécificité de leur expérience collective.
Sur le plan économique, la citoyenneté jordanienne facilite l’insertion professionnelle des réfugiés, notamment dans les services de l’UNRWA et dans les économies en pleine expansion du Golfe. Cette émigration, encouragée par les autorités jordaniennes, devient une ressource précieuse : les remises de fonds envoyées par les travailleurs expatriés représentaient jusqu’à 28% du PIB avant la crise du Golfe de 1990. Elle contribue à améliorer le niveau de vie des familles palestiniennes, tout en soutenant la stabilité économique du royaume.
Mais cette intégration n’est pas sans tensions sociales. L’arrivée massive de réfugiés entraîne une concurrence accrue sur le marché du travail, provoquant une baisse des salaires et un sentiment d’injustice chez les Transjordaniens les plus modestes. Ces derniers perçoivent comme une inégalité le fait que les réfugiés bénéficient des services sociaux de l’UNRWA, dont eux-mêmes sont exclus. Cependant, si une partie de la bourgeoisie et des notables palestiniens s’intègre dans l’élite du royaume – certains accédant à des fonctions ministérielles – les postes stratégiques liés à la sécurité, à la défense et à la monarchie leur demeurent systématiquement fermés.
Cette politique d’intégration contrainte nourrit une méfiance entre la monarchie et ses nouveaux citoyens. L’assassinat du roi Abdallah Ier à Jérusalem, le 20 juillet 1951, par le Palestinien Mustapha Ashu, en offre une illustration éloquente. Dès lors, l’articulation entre Jordaniens d’origine et Palestiniens naturalisés s’installe d’emblée sur un équilibre incertain et asymétrique, où l’intégration proclamée se double de défiance et de neutralisation des différences.
La bataille pour l’État: une cohabitation impossible entre l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) et la monarchie (1967–1988)
La Naksa de juin 1967 constitue une nouvelle secousse pour la Jordanie et pour l’ensemble du monde arabe. En à peine six jours, Israël inflige une défaite écrasante aux armées arabes et occupe la Cisjordanie, Jérusalem-Est, le Sinaï et le Golan. Plus de 250 000 réfugiés franchissent alors la rive est du Jourdain, accentuant la proportion de Palestiniens dans le royaume.
Si l’Organisation de libération de la Palestine, née en 1964, sort initialement discréditée du conflit; la défaite agira enfin comme catalyseur: les factions de la résistance se recomposent au sein de l’OLP, le Fatah s’impose progressivement et, sous la direction de Yasser Arafat à partir de février 1969, l’organisation se mue en machine à la fois militaire et sociale – guérilla extérieure, mais aussi services d’éducation, de santé et pensions destinées aux familles des combattants.
Amman devient rapidement la principale base arrière de cette OLP renforcée. Les camps jordaniens fournissent l’essentiel des recrues; dans certaines régions, la population palestinienne, désormais majoritaire, rend la cohabitation profondément paradoxale. D’un côté, la monarchie tolère d’abord la circulation de ces forces comme un levier de pression contre Israël ; de l’autre, la transformation des fedayins en une puissance organisée – près de 40 000 hommes armés – finit par constituer un véritable État dans l’État, érodant la souveraineté royale.
Là se joue un nœud central: le renforcement de la légitimité et de l’autonomie politique de l’OLP met en tension la capacité du roi Hussein à maintenir son autorité sur les Palestiniens et à consolider un narratif d’unité nationale.
Progressivement, la multiplication des opérations palestiniennes depuis la Jordanie et les représailles israéliennes qui s’ensuivent enveniment les relations entre la résistance et le régime. En 1970, après la tentative d’assassinat du roi Hussein et des prises d’otages dans des hôtels d’Amman, le FPLP détourne plusieurs avions (les événements de Dawson’s Field) et en fait sauter certains devant la presse. Le 16 septembre, Hussein décrète la loi martiale et lance une offensive majeure contre Amman et les camps palestiniens. Les combats – notamment la bataille d’Amman – font, selon les estimations, entre 5 000 et 10 000 morts. Parallèlement, une incursion syrienne destinée à soutenir l’OLP est repoussée avec de lourdes pertes. Si un cessez-le-feu est finalement signé au Caire le 27 septembre sous l’égide de Nasser, la répression royale se poursuit: l’OLP est affaiblie, ses forces évacuées et la Jordanie rétablit son contrôle sur le territoire. «Septembre Noir», par son bilan humain et l’expulsion quasi totale des fedayins vers le Liban, marque ainsi une rupture irréversible entre le régime hachémite et la résistance palestinienne.
Exilée, l’OLP conserve tout de même un poids symbolique et organisationnel fort qui se manifeste sur la rive ouest, où ses réseaux progressent malgré l’occupation israélienne. Sur la scène arabe, la reconnaissance de l’OLP par la Ligue arabe en 1974 comme «seul représentant du peuple palestinien» marque la victoire diplomatique d’un mouvement qui, malgré son échec militaire, a su se transformer en autorité politique transnationale. Les scrutins locaux de 1976, donnant la majorité aux candidats pro-OLP en Cisjordanie, et le déclenchement de l’Intifada en 1987, confirment la perte progressive de l’emprise jordanienne sur la rive ouest et l’émergence d’un acteur palestinien autonome sur la scène nationale.
Le désengagement officiel de juillet 1988 concrétise cette évolution: en annonçant la suspension des liens administratifs et judiciaires avec la Cisjordanie et en proclamant «La Jordanie est la Jordanie, la Palestine est la Palestine», Hussein tourne la page d’une ambiguïté diplomatique vieille de près de quarante ans. Le geste poursuit plusieurs objectifs: consolider une identité jordanienne distincte, écarter le fardeau politique d’une représentation territoriale contestée, et neutraliser l’accusation israélienne selon laquelle «la Jordanie serait la Palestine».
Pragmatisme étatique et colère populaire: la marginalisation législative des droits palestiniens (1990 – 2005)
Sur le plan diplomatique, les années 1990 marquent l’érosion progressive du droit au retour des Palestiniens comme principe central des négociations régionales et des accords signés à la fin du siècle.
A la suite de la conférence de Madrid, les accords d’Oslo (1993) déplacent ce droit revendiqué à des «questions de statut permanent» suspendues à des négociations ultérieures, sans calendrier précis ni garanties fermes.
Le traité de Wadi Araba (ou traité de paix Jordanie-Israël, 1994) vient compléter ce déplacement du centre diplomatique de gravité, en fixant des relations bilatérales formelles entre Amman et Tel Aviv, et en traitant indirectement de questions liées aux réfugiés via les mécanismes de coopération régionale – comme un enjeu humanitaire gérable plutôt que comme une revendication politique inaliénable. La référence à la résolution 194[8] est évacuée au profit d’une approche technocratique centrée sur la «mise en œuvre de programmes des Nations unies». Ce glissement doublement stratégique – soulager Amman de la charge diplomatique et neutraliser la portée politique des réfugiés palestiniens – a durablement redéfini les contours du possible pour ces-derniers.
Si, pourtant, la Jordanie continue d’affirmer son attachement au principe du retour, cette position relève moins d’une défense effective d’un droit individuel que d’une stratégie de préservation de l’équilibre interne du royaume. Au nom de cette logique, l’identité palestinienne est marginalisée et tout nouvel afflux de réfugiés refusé, au motif qu’il consacrerait le «projet sioniste» d’une «patrie alternative» en Jordanie. Derrière cette rhétorique officielle, réitérée récemment sur la scène internationale[9], se profile avant tout la volonté de contenir les arrivées et d’encourager les départs.
Cette ambiguïté a ainsi transformé le droit au retour en un instrument de gestion politique plutôt qu’en une promesse mobilisatrice, révélant la tension qui traverse la «jordanisation» de l’identité palestinienne: un État en construction confronté à l’altérité et sa mémoire collective.
La résurgence populaire qui se manifeste dans l’Intifada d’al-Aqsa (6 septembre 2000) illustre l’échec des efforts diplomatiques, tant jordaniens qu’internationaux, à capter l’énergie nationale palestinienne. Si certaines composantes de la société jordanienne se mobilisent en soutien aux Palestiniens, attestant d’une empathie sociale et proximité transfrontalière, la couronne se trouve dans un exercice d’équilibriste: soutenir l’élan populaire sans déclencher une rupture avec Israël. En effet, la construction du mur de séparation en Cisjordanie (juin 2002) et la rhétorique de certains responsables israéliens exacerbent la crainte d’un transfert massif de populations vers la Jordanie, plaçant Amman devant un dilemme de souveraineté et de capacité d’accueil. Sous cette pression, l’État jordanien adopte une posture de fermeture: il restreint les visites depuis la Cisjordanie, refuse d’accueillir certains Palestiniens expulsés (cas de Bethléem en 2002) et bloque des personnes abandonnées à la frontière irako-jordanienne en 2003. Ce choix n’est pas seulement bureaucratique; il est stratégique: limiter un afflux imprévisible pour préserver l’ordre intérieur et éviter d’être perçu comme le réceptacle permanent d’une solution imposée. Mais ce pragmatisme de gestion nourrit une profonde ambivalence politique : soutenir moralement une cause tout en excluant concrètement ses victimes renforce le sentiment, chez beaucoup de Palestiniens, d’une marginalisation institutionnalisée.
Unifier pour exclure: le paradoxe jordanien contemporain (2005 - 2025)
Peu après le déclenchement de la seconde Intifada, le roi Abdallah II lance la campagne nationale « La Jordanie d’abord », une initiative délibérée visant à réaffirmer l’unité nationale face aux instabilités internes et régionales. Dix ans plus tard, la campagne «Nous sommes tous la Jordanie» s’inscrit dans la même logique. Toutes deux mobilisent des slogans, des dispositifs institutionnels et des campagnes publiques destinés à ancrer la fidélité à la patrie et à promouvoir l’idée d’une appartenance jordanienne commune à l’ensemble des citoyens. En affirmant cette unité, le royaume cherche à normaliser l’assimilation des Jordano-Palestiniens au récit national dominant.
Ce discours d’unification dissimule par ailleurs le refus de la Jordanie d’absorber de nouveaux flux palestiniens susceptibles de modifier l’équilibre démographique et politique – un phénomène devenu particulièrement visible dans les deux dernières années. Dès octobre 2023, le roi s’est publiquement opposé à toute perspective d’exode massif de Gazaouis vers la Jordanie[10], affirmant que la crise humanitaire palestinienne devait être gérée sur son propre sol[11]. La narrative est claire: «35% de notre population sont des réfugiés, […] nous ne voulons pas que les Palestiniens viennent en Jordanie »[12]. Cette politique produit un credo clair: unifier l’intérieur sans laisser s’y greffer de nouvelles singularités démographiques, en encourageant une solution palestinienne qui ne passe pas par un échange démographique en Jordanie.
L’effet concret de ce double langage est structurel. Des pratiques administratives et politiques se développent, dessinant une citoyenneté différenciée: privation arbitraire de nationalité de plusieurs milliers de personnes d’origine palestinienne au milieu des années 2000, quotas implicites dans l’accès aux postes sensibles, tracés électoraux favorisant les circonscriptions rurales est-jordaniennes… Autant de mécanismes qui, sans se dire discriminatoires, produisent des citoyens à deux vitesses. De plus, la gestion des camps et des populations réfugiées cristallise cette ambivalence: des programmes de réhabilitation et des slogans de «réintégration» coexistent avec le maintien d’un cadre humanitaire (UNRWA) et des politiques qui limitent l’installation définitive. Là où l’État investit en infrastructures et en services, il le fait souvent dans une logique de stabilisation et de contrôle, non d’intégration politique pleine et entière.
Pourtant, cette marginalisation politique et symbolique de la composante palestinienne n’a pas fait disparaître les inquiétudes identitaires au sein de la société jordanienne. Depuis les années 2000, la résurgence d’un discours nationaliste transjordanien traduit la persistance d’une crainte diffuse d’un bouleversement démographique et politique susceptible d’altérer la nature même de l’État. Ces tensions s’enracinent aussi dans la transformation économique du royaume. En effet, depuis la libéralisation initiée à la fin des années 1980 et la privatisation des secteurs publics, les élites d’origine palestinienne ont accru leur poids dans l’économie privée et les circuits financiers, tandis que nombre de Transjordaniens, longtemps soutenus par l’emploi public et militaire, se sentent relégués ou menacés par cette recomposition. La perception d’une inégalité croissante nourrit un discours de dépossession : la Jordanie «économique» serait palestinienne, la Jordanie «politique» transjordanienne.
Les politiques récentes de cohésion nationale butent donc – encore et toujours – sur la réalité sociale, démographique et régionale. Avec des enjeux fondamentaux refaisant récemment surface avec une vigueur nouvelle, l’exclusion des nouveaux flux palestiniens et la marginalisation persistante de ceux déjà établis rappelle combien l’unité proclamée demeure à la fois précaire et paradoxale.
Ainsi, la «jordanisation» de l’identité palestinienne se présente moins comme une stratégie cohérente que comme un régime de gestion discordant.
D’un côté, la présence palestinienne a été constitutive de l’État jordanien: flux démographiques massifs, capital humain, transferts économiques et dynamisme social ont façonné la construction et le développement du royaume. De l’autre, l’action étatique se limite à une intégration relativement symbolique, encadrée par des dispositifs administratifs et symboliques qui privilégient l’harmonie apparente sur l’égalité effective. Ce double mouvement est l’essence même du paradoxe: l’intégration y devient un cadre formel, une appartenance de façade, plutôt qu’une pleine inclusion politique. La légitimation d’une cohésion affichée se paie par ailleurs au prix d’effets collatéraux durables: elle fragilise la légitimité morale de l’État aux yeux d’une part significative de la population et nourrit des risques politiques à moyen terme.
Cette tension montre combien il est difficile pour un État jeune et hétérogène de transformer un récit performatif en réalité politique tangible. A terme, cette «jordanisation» ne pourra se maintenir drapée dans les seuls keffiehs rouges et blancs, symboles de la Jordanie, qui en effacent le noir et blanc palestinien. Pour que cette «fiction» devienne réellement créatrice, elle devra faire descendre ses symboles sur le terrain du réel, traduire son récit national de cohésion en droits et représentation effectifs. Faute de quoi, l’unité affichée ne sera qu’un décor fragile, derrière lequel continueront de courir les lignes de faille d’une société divisée.
Notes
[1] Thiesse, 2000
[2] Anderson, 1983
[3] Massad, 2001
[4] Dans la lignée des travaux de Billig (1995) sur le «nationalisme banal», ce sont Fox et Miller-Idriss (2008) qui reprennent l’étude de ce phénomène
[5] La rivalité entre les clubs Faisaly (historiquement transjordanien) et Wahdat (issu du camp de réfugiés palestinien éponyme) illustre ainsi les tensions identitaires persistantes.
[6] La substitution du qāf, par «k» en dialecte palestinien ou par «g» en jordanien oriental, devient un marqueur social et politique. En 2017, le président du Wahdat Club, prononça Teklakūsh («ne vous inquiétez pas») à la palestinienne avant de «corriger» sa prononciation plus tard: les choix phonétiques acquièrent bien une portée identitaire, voire nationaliste.
[7] Le mansaf, symbole du nationalisme transjordanien, s’oppose à la mulūkhīya, associée aux Palestiniens. Après la victoire de Wahdat en 2014, ses supporters surnomment le championnat «Mulūkhīya Champions League», ce à quoi les fans de Faisaly répondent: «Prends ta mulūkhīya et va vers le pont», référence au pont Allenby, frontière entre Jordanie et Cisjordanie.
[8] Les réfugiés qui le veulent doivent pouvoir «rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible et vivre en paix avec leurs voisins»; les autres doivent être indemnisés de leurs biens «à titre de compensation».
[9] Lors d’un discours à l’Assemblée générale de l’ONU en 2024, le roi Abdallah II a qualifié l’idée de présenter la Jordanie comme une patrie alternative pour les Palestiniens de «grave erreur». Il a affirmé: «Cela n’arrivera jamais. Nous n’accepterons jamais le déplacement forcé des Palestiniens, ce qui constitue un crime de guerre.»
[10] À Berlin, à l’issue d’un entretien avec le chancelier allemand Olaf Scholz, il déclare: «Pas de réfugiés en Jordanie, pas de réfugiés en Égypte; c’est une ligne rouge.»
[11] Le Premier ministre jordanien, Jaffar Hassan, a souligné que le royaume refusait «tout plan de déplacement ou de réinstallation des Palestiniens aux dépens de la Jordanie».
[12] Citation d’Ayman Safadi, Ministre jordanien des Affaires étrangères, lors de la 61e session de la Conférence de Sécurité de Munich.