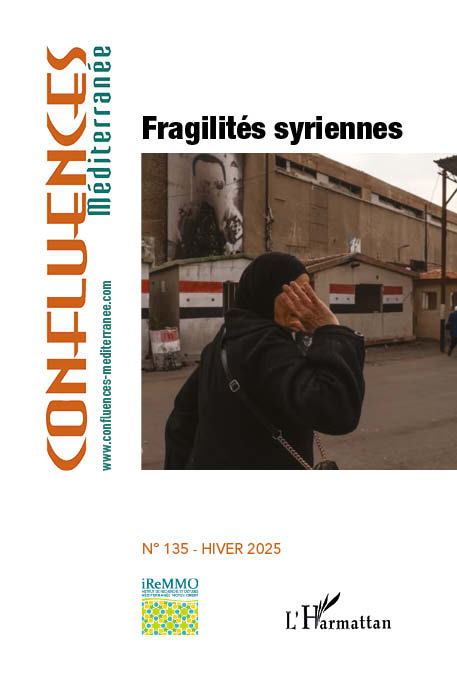Le raï, musique née en milieu rural en Oranie, à l’ancrage profondément berbère, connaît une trajectoire migratoire et culturelle complexe qui l’amène à devenir une musique diasporique urbaine emblématique de Paris, en particulier du quartier de Barbès. Ce déplacement illustre une transculturation (Ortiz, 1940/2011), c’est-à-dire un processus par lequel l’emprunt par une communauté de certains éléments de la culture majoritaire pour se les approprier et les refaçonner à son propre usage. En effet, les codes ruraux et vernaculaires du raï se recomposent dans un contexte migratoire urbain, participant à la construction identitaire des communautés maghrébines parisiennes. Ainsi, comment le raï devient une musique arabe à Paris, en dépit de ses origines berbères, oranaises et populaires ?
Le raï, musique populaire: trajectoire d’une musique nomade citadinisée
Le raï naît au début du XXe siècle dans les milieux ruraux de l’Ouest algérien, aux marges de la grande poésie populaire chantée. Il voit le jour en partie en réaction à l’élitisme de cette poésie. Le raï, dans ses débuts, est issu de la créativité sociale en lien avec la déculturation et la déstructuration de la société paysanne (Virolle, 2003). Il prend ses racines dans les chants bédouins et nomades des régions du sud de l’Algérie. Dans les années 1920 et 1930, dans les bidonvilles d’Oran, les musiciens locaux commencent à combiner les sons du chaâbi[1], de la musique berbère et des traditions musicales andalouses avec des influences musicales européennes telles que le jazz, le rock et le funk. Il s’agit d’une musique profondément ancrée dans un enracinement vernaculaire et une esthétique populaire, initialement diffusée dans des circuits informels, souvent clandestins.
Il faudra attendre le début des années 1970 et l’exil rural des jeunes d’Oran et de Sidi Bel Abbes pour que le raï retentisse jusqu’à la ville d’Alger. Le raï électrique apparaît alors comme nouveau genre musical dans les cabarets d’Oran, lieux de consommation d’alcool et de divertissement pour hommes avec des femmes professionnelles (Schade-Poulsen, 1998). Bien avant qu’il atterrisse à Paris, le raï s’invente comme une musique de marge, née de circulations, de métissages et de résistances sociales. Ce caractère hybride et contestataire en fait une matière sonore particulièrement propice à être rédigée, redéfinie et appropriée. Dès lors, lorsqu’il franchit la Méditerranée, le raï ne se contente pas d’être importé: il devient un terrain d’actualisation identitaire et un support de redéfinition des musiques arabes dans le contexte parisien, par les diasporas d’Afrique du Nord.
À partir des années 1970, le raï franchit la Méditerranée pour transiter d’Alger à Paris, porté par les mobilités migratoires nord-africaines. Les foyers d’immigrés, les cassettes pirates et les tourneurs jouent un rôle central dans la circulation et la recomposition de cette musique dans les quartiers à forte population nord-africaine, notamment à Barbès. Dans ce contexte, ce quartier du XVIIIe arrondissement parisien devient un espace-clé de recomposition, de diffusion et de légitimation de cette musique au sein de la diaspora nord-africaine (Ben Boubaker, 2024). Le quartier a la spécificité de concentrer le plus de disquaires, parmi les plus emblématiques, on compte le célèbre Chez Sauviat, un des seuls encore en activité. Dès les années 1950, Léa Sauviat, fille d’un couple d’auvergnats ayant ouvert une boutique de disques, se spécialisera petit à petit dans les musiques nord-africaines, pour répondre à la demande des ouvriers algériens qui viennent rechercher dans le quartier du XVIIIe arrondissement de Paris des souvenirs de leur pays.
Cette reconfiguration du raï comme musique arabe à Paris ne peut se comprendre sans prendre en compte les logiques de classification raciale héritées du colonialisme français. Il faut tout d’abord souligner que les catégories «Arabe» et «Berbère» sont des constructions coloniales, forgées par les administrations françaises pour diviser et gouverner les populations nord-africaines (Rouighi, 2019). En essentialisant les Arabes comme fatalement religieux et collectifs, et les Berbères comme plus individualistes et potentiellement assimilables, les autorités coloniales ont inventé une hiérarchie raciale sans fondement historique dans la réalité des sociétés locales. Cette assignation dichotomique a perduré en France après l’indépendance, et s’est amplifiée. Quand elles sont appliquées à la musique, ces catégories agissent comme des filtres puissants qui influencent la manière dont le raï est perçu, nommé et diffusé dans l’espace parisien. Ainsi, alors que le raï est profondément ancré dans des traditions berbères, il est progressivement rangé sous l’étiquette de musique «arabe».
À Barbès, cette classification continue d’agir, tout en étant parfois contournée par les pratiques de recherche musicale identitaire par les travailleurs immigrés. Rencontré par le DJ et digger Hadj Sameer pour son documentaire Raï is not dead, le chanteur algérien Sofiane Saidi raconte: «Dès que j’avais le mal du pays, dès que je sentais qu’il me manquait un truc, j’allais automatiquement à Barbès, il y avait du raï partout. Et des fois tu croisais même les chanteurs! En fait, quand tu savais pas quoi faire quand tu arrivais à Paris, tu faisais Orly-Barbès direct, et tu trouvais tous tes repères»[2]. Pour de nombreux Nord-africains installés à Paris, la recherche musicale relevait moins d’une pratique culturelle détachée que d’un geste profondément affectif : chercher des disques ou retrouver une ambiance sonore à Barbès, c’était compenser l’absence, pallier l’éloignement du pays, réactiver des repères familiers. «Ils sont nombreux à venir à Barbès acheter un bout de pays sur disque cylindrique»[3]. Que ce soit dans les cafés, chez les disquaires, ou à l’écoute des voix familières du raï, leur recherche sonore s’inscrivait dans une quête d’appartenance et un besoin de communauté.
Barbès devient ainsi bien plus qu’un simple lieu de consommation musicale: le quartier se transforme en scène active de redéfinition du raï. A travers leur quête affective et mémorielle, les immigrés nord-africains à Paris participent à faire du raï une musique perçue comme arabe, déterritorialisée, mais jamais déracinée. Ils transforment une musique populaire algérienne en un symbole sonore diasporique, chargé d’appartenances multiples. C’est un geste de réécriture culturelle, qui se poursuivra lorsque le raï explose dans les années 1980-1990.
Le raï, produit culturel global: musique de beurs ou musique du monde?
Le raï, produit culturel globalisé à Paris, oscille entre commercialisation massive, stigmatisation sociale et réappropriation identitaire. Il incarne un paradigme où la musique, tout en accédant aux circuits mondiaux de la world music, conserve une dimension de résistance et d’affirmation postcoloniale, notamment à travers l’action des jeunes générations issues de l’immigration algérienne, les beurs[4], qui poursuivent la recherche sonore entamée par leurs parents.
Durant la décennie noire algérienne[5], la France devient un refuge pour les artistes raï, ce qui amplifie le rayonnement international du genre. Le concert organisé en 1986 par la Maison de la Culture de Bobigny (MC93) marque un tournant symbolique dans l’internationalisation du raï, réunissant les principales figures du genre: Raïna Raï, Cheb Khaled, Cheb Sahraoui et Chaba Fadela, Cheb Hamid et Cheb Mami. C’est la première fois que Cheb Khaled se produit en France. Le journaliste et producteur français Martin Meisonnier, découvreur du raï[6], se souvient du concert:
«Les 2000 places ont été prises d’assaut et les 2000 personnes restées dehors essayaient de se frayer un chemin à l’intérieur. Ce succès était totalement inattendu pour un Khaled qui n’avait pas de passeport et dont le concert en banlieue n’avait bénéficié que d’une petite campagne de publicité. Mais il était déjà légendaire et sa légende l’avait précédé.»[7]
Dans les années 1990, en partie sous l’impulsion du ministre de la culture de l’époque Jack Lang, Paris est consacrée ville de la world music. Le raï devient donc une musique du monde. L’une de mes enquêtées, chercheuse spécialisée dans les musiques du monde arabe, atteste:
C’est vrai que de manière générale, grandir en France dans les années 90, c’était vraiment la grande période du raï. Même si on était dans la 3robiya la plus totale et que mes parents n’avaient pas la TV, on entendait à la radio ou parfois quand on allait chez les copains regarder les émissions de clip, le samedi matin, il y avait Sawt Al Atlas par exemple, il y avait 1 2 3 soleil; Faudel, etc. C’était totalement normal et banalisé, cette présence de la musique nord-africaine, par le raî, dans l’espace culturel et musical français. (Entretien, 2025)
Le raï s’est adapté à des réalités provenant de circonstances sociales, économiques, culturelles et économiques différentes (Marranci, 2001). Pour mieux comprendre ses évolutions, il est judicieux de se référer à la transculturation musicale, théorisée par l’ethnomusicologue Margaret Kartomi (1981). La trajectoire du raï laisse place à plusieurs transculturations musicales, différents genres de raï sont nés d’éléments exogènes: l’exode rural, le colonialisme, l’émigration et la naissance d’une génération de beurs en France, qui réinventent le raï. Ils jouent un rôle essentiel dans la réappropriation du raï à Paris. Au-delà de la simple écoute, leur démarche consiste à mettre en commun un patrimoine hérité de leurs parents et des influences de «musique urbaines» (rap, funk, reggae). C’est ce qui donne le raï made in France (Marranci, 2001), qui correspond à une forme d’hybridité culturelle (Bhabha, 2007) qui participe à la construction identitaire biculturelle des beurs de France.
Le raï parisien incarne ainsi une double dynamique: celle d’un produit globalisé et commercialisé dans la world music, mais aussi celle d’une musique profondément engagée dans les enjeux d’identité, de mémoire et de résistance postcoloniale. À travers la recherche musicale identitaire et la transculturation, le raï témoigne des tensions et des créations qui façonnent la fabrique d’une musique «arabe» à Paris, à la croisée des marchés mondiaux et des luttes identitaires locales.
De Zayneb AIT ALI OUALI
Notes
[1] Musique populaire algérienne du début du XXe siècle.
[2] Hadj Sameer. (2022). Raï is not dead [Série documentaire]. Arte. https://www.arte.tv/fr/videos/RC-021097/rai-is-not-dead/ Dans cette série documentaire, le DJ et digger parisien d’origine algérienne Hadj Sameer retrace l’histoire du raï, « à l’envers », en partant de Barbès pour arriver à Oran, l’idée étant de créer un mix de sons résumant son itinéraire.
[3] Ben Boubaker, H. (2023). Barbès Blues : Une histoire populaire de l’immigration maghrébine (p. 192). Paris : Éditions du Seuil.
[4] Beur est un néologisme utilisé pour les personnes nées sur le territoire français et dont les parents sont immigrés d’un pays du Maghreb, ou plus généralement d’un pays arabe.
[5] La décennie noire algérienne désigne la période de guerre civile qui s’étend entre 1991 et 2002. Les artistes algériens sont directement visée par les violences politiques. Le chanteur de raï Cheb Hasni est assassiné à Oran en 1994.
[6] Martin Meisonnier est à l’initiative du concert de raï à la MC93 de Bobigny.
[7] François Bensignor. (2015). Le raï fête ses 30 ans. Hommes & migrations, (1312), 150–155.
Bibliographie
Ben Boubaker, H. (2024). Barbès Blues: Une histoire populaire de l’immigration maghrébine. Paris: Seuil.
Bensignor, F. (2015). Le raï fête ses 30 ans. Hommes & migrations, (1312), 150–155.
Bhabha, H. K. (2007). Les lieux de la culture: Une théorie postcoloniale (F. Bouillot, Trad.). Paris: Payot. (Œuvre originale publiée en 1994)
Kartomi, Margaret J., 1981 «The Processes and Results of Musical Culture Contact: A Discussion of Terminology and Concepts», Ethnomusicology 25 (2): 227-249.
Marranci, G. (2001). Le raï aujourd’hui: Entre métissage musical et world music moderne. Cahiers d’ethnomusicologie, (13), 139-149.
Ortiz, F. (2011). Controverse cubaine entre le tabac et le sucre (J. Poinsot, Trad.). Montréal: Mémoire d’encrier. (Œuvre originale publiée en 1940)
Schade-Poulsen, M. (1998). Le raï et ses espaces de rencontres musicales. In S. Ossman (éd.), Miroirs maghrébins (1‑). CNRS Éditions.
Virolle, M. (2003). L’épopée de la chanson raï. Recherches Internationales, (67–68), 291–314.