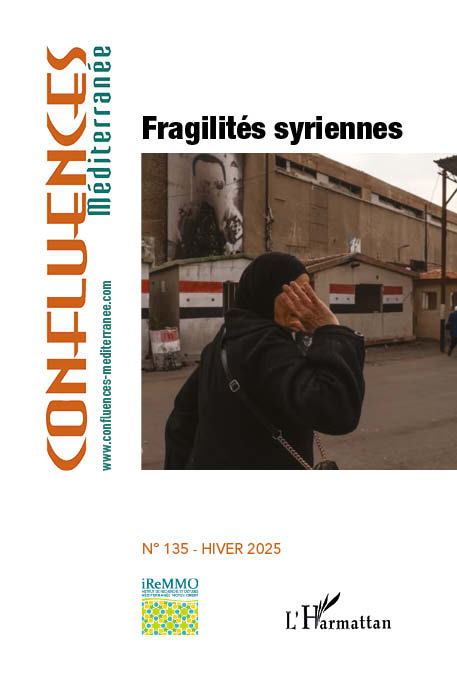L’Iran des mollahs souhaite accéder au rang de puissance nucléaire. L’occident lui conteste ce droit. Pendant des années, le régime a souligné l’usage de réacteurs nucléaires pour une utilisation civile. Depuis 2002, la révélation de plusieurs sites d’enrichissements nucléaire par des opposants en exil a procuré de sérieux doutes sur une utilisation pacifique de son énergie. Aujourd’hui, ce n’est plus un secret: l’Iran mobilise ses scientifiques et son savoir-faire afin de pouvoir assembler un engin explosif en un temps record, si jamais le régime venait à se sentir menacé.
Ces sites, non déclarés auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) remettent constamment en cause la bonne volonté du régime qui continue de s’enrichir à l’uranium. D’ailleurs, selon le dernier rapport de 2025, le régime dispose d’un stock total d’uranium enrichi de 9 247,6 kg, soit 45 fois la limite autorisée. Il n’y a pas de justification civile pour un tel niveau d’enrichissement d’uranium.
En parallèle, le pays continue également de développer son arsenal de missiles longue portée qui, une fois couplé au programme nucléaire, pourrait faire de l’Iran la plus grande puissance militaire de la région. En Europe, la décision urgente de stopper le programme nucléaire s’est emparée de la classe politique. Même si l’Union européenne a voté en faveur d’un embargo sur l’importation de pétrole iranien et du gel des avoirs de la Banque centrale d’Iran, le scénario d’un régime des mollahs nucléarisé se précise d’année en année. Dans le monde arabe, le programme nucléaire iranien soulève également une obsession à travers une potentielle intention hégémonique de l’influence chiite.
Entre la volonté de l’Occident d’empêcher un régime islamique d’acquérir une telle arme et la montée des tensions géopolitiques avec l’État hébreu, l’Iran s’est récemment heurté à la doctrine sécuritaire occidentale. Face aux déclarations du régime, la poursuite de l’enrichissement à l’uranium peut-elle constituer un véritable argument tangible à la consolidation du pouvoir des mollahs ?
Des révélations clandestines à l’intervention américaine : la genèse d’un programme sous tension
Le régime iranien utilise une multitude de sites nucléarisés pour développer son arsenal atomique. Et surtout, pour garder une discrétion, il utilise sa géographie avantageuse pour répartir la construction des infrastructures. On compte quatre sites principaux, dont Ispahan, Natanz, Arak et Fordo, qui sont étroitement surveillés par la communauté internationale. Certains de ces sites, ont attiré l’œil des inspecteurs de l’AIEA car la localisation géographique qu’ils impliquent est unique. C’est le cas du site de Fordo, construit à l’intérieur d’une montagne dans la région de Qom. Ce dernier, situé à environ 80 mètres sous terre avec plusieurs couches de béton armé est entouré de plusieurs bases militaires rendant très difficile une intervention militaire extérieure. Abritant environs 2000 centrifugeuses avancées (type IR-6) avec un niveau d’enrichissement à hauteur de 60%, sa construction a longtemps été tenu secrète.
Ce site préoccupant, est devenu le symbole des tensions entre l’Iran et la communauté internationale. Pourtant, entre l’accord de Vienne (2015) et le retrait des États-Unis en 2018, les sanctions économiques n’ont pas dissuadé le régime de poursuivre l’enrichissement grâce à ses centrifugeuses.
Finalement, le seul acteur à avoir fait reculer le programme iranien, c’est Israël. En effet, l’acceptation d’une potentielle acquisition de l’arme atomique est inacceptable pour sa sécurité. L’Etat hébreu a mené pendant des années une guerre clandestine pour éliminer les têtes pensantes du programme nucléaire. Pour gagner du temps, des actes de sabotage comme les virus Stuxnet (2010) et Flame (2012) se sont avérés très performants pour paralyser une partie des centrifugeuses à l’uranium. De plus, l’utilisation de frappes aériennes en profondeur s’est avérée utile pour toucher des cibles en surface. Mais pour ce qui concerne des objectifs situés en profondeur dans le sol, Tsahal ne possède pas d’armement adéquat.
Dans la nuit du 21 au 22 juin 2025, les États-Unis ont accepté de mener une attaque spectaculaire contre les principaux sites concernés. L’armée américaine est la seule à posséder la bombe GBU-57, une ogive capable de s’enfoncer à des dizaines de mètres de profondeur avant d’exploser. Dans ce contexte, il s’agit d’une arme précieuse pour atteindre les salles souterraines du site de Fordo. Selon l’allocution du président Donald Trump à la Maison-Blanche, 14 bombes larguées auraient totalement détruit les installations nucléaires de Fordo, Ispahan et Natanz. Le projet iranien est désormais fortement compromis. Cependant, malgré les dommages subis par les sites, le régime a annoncé par la voix du ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghtchi, que le pays ne renoncera pas pour autant à son programme nucléaire. Même si l’Iran reste très affaibli après cette escalade appelée « guerre des douze jours », de nombreux signaux laissent présager que cette question du nucléaire iranien n’est pas terminée.
Continuité de l’enrichissement: des scénarios potentiels
Tout d’abord, il est fort probable que le régime remobilise ses infrastructures afin de retrouver rapidement un niveau élevé d’enrichissement, sans franchir le seuil de l’arme nucléaire. L’objectif sera de revenir au niveau d’enrichissement « d’avant bombardement » pour conserver l’atout civil, sans déclaration d’intention offensive. L’Iran cherchera ainsi à recréer les conditions du « breakout capacity », c’est-à-dire la capacité d’acquérir un engin explosif comme un fait accompli, avant que des pressions diplomatiques ou une action militaire ne puissent l’en empêcher.
Ensuite, assujetti à des tensions politiques internes, il est possible que le régime islamique puisse se sentir menacé. Le scénario dans lequel Téhéran déciderait d’accélérer ses recherches scientifiques en toute transparence afin d’obtenir du matériel fissile de qualité militaire sans tenir compte de ses engagements internationaux, reste possible mais peu probable. En effet, les conséquences internationales seraient lourdes pour un régime déjà isolé. Par ailleurs, l’échec de la communauté internationale à dissuader l’Iran d’obtenir des résultats militaires l’affaiblirait elle-même, en lui faisant perdre la crédibilité du traité de non-prolifération. D’autres Etats pourraient alors être tentés de suivre la voie de l’Iran.
Enfin, le scénario le plus probable reste celui d’une escalade régionale sans recours à l’arme nucléaire. L’enrichissement de l’uranium se poursuivra tout comme les ripostes non conventionnelles, grâce à des sabotages, des frappes ciblées recourant massivement au vecteur aérien, ou encore à des assassinats de hauts gradés des Gardiens de la révolution. De plus, une seconde intervention américaine de grande ampleur dans les années à venir n’est pas à exclure en fonction des taux d’enrichissement. De son côté, l’Iran se retrouve avec des proxys (Hezbollah, Hamas, Houthis) très affaiblis. Il pourra toujours utiliser son arsenal balistique pour faire pression sur l’Etat hébreu et jouer de sa position géographique régionale pour fermer le détroit d’Ormuz.
Riposte iranienne et répercussions géopolitiques au Moyen-Orient
En réponse à l’impact des bombes GBU-57, l’Iran a formulé une riposte dont l’intensité reste relativement timide. En effet, des salves de missiles ont été lancées contre des bases américaines en Irak et au Qatar, dont la majorité a été interceptée. Cet épisode pourrait constituer un tournant stratégique au Moyen-Orient, marquant un changement de posture des États-Unis. Alors que le président Donald Trump s’était initialement engagé à éviter toute escalade des tensions, il a finalement opté pour une démarche fondée sur l’usage de la force plutôt que sur la diplomatie. Cela réintroduit la définition interventionniste de la 1ère puissance mondiale, qui pourrait se reproduire dans de futures crises internationales.
La France, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont proposé une échéance fixée à la fin du mois d’août pour parvenir à un nouvel accord concernant le programme nucléaire de Téhéran. L’objectif est de permettre au régime de prendre pleinement connaissance des événements, afin de l’inciter à renoncer à l’usage militaire de l’uranium. En l’absence de résolution diplomatique, la décision du “snapback” entraînera la réactivation automatique de l’ensemble des sanctions onusiennes à l’encontre de l’Iran, sans qu’un nouveau vote du conseil de sécurité ne soit requis.
En conclusion, il reste très difficile d’établir une évaluation précise des dommages occasionnés par les bombardements américains sur les installations nucléaires iraniennes. Néanmoins, il est avéré qu’une portion significative du programme ai été neutralisée. Selon le directeur de l’AIEA, il est fortement possible qu’une évacuation préalable à l’attaque américaine aurait permis de transférer une partie de la matière fissile de Fordo vers un autre site. L’hypothèse d’un transfert de matière fissile vers un site non déclaré demeure fortement plausible, offrant ainsi aux autorités iraniennes la possibilité de poursuivre leurs activités nucléaires en dehors du cadre officiel. Cette information pourrait correspondre à une stratégie délibérée du régime pour continuer à maintenir un état de seuil nucléaire. Cette hypothèse est corroborée par les services de renseignement américains, elle pourrait gagner en crédibilité dans les mois à venir. Déjà isolé économiquement en raison de son programme nucléaire et confronté à des tensions politiques croissantes, l’Iran subit l’impact des sanctions qui engendrent de profonds problèmes structurels sur sa population. Lors de ces derniers mois, la poursuite du programme d’enrichissement a constitué un facteur d’affaiblissement politique pour le régime. Aujourd’hui, la question centrale reste de savoir si celui-ci poursuivra réellement son programme et jusqu’à quel point la population iranienne pourra continuer à le tolérer.
Sources
Daguzan, J.-F. (2010). L’Iran nucléaire: le moment de décision? Les Cahiers de l’Orient, 99(3), 91-102. https://doi.org/10.3917/lcdlo.099.0091.
Connaissances des énergies (22 juin 2025) Les principaux sites connus du programme nucléaire iranien. Lien: https://www.connaissancedesenergies.org/afp/les-principaux-sites-connus-du-programme-nucleaire-iranien-250622-0#:~:text=NATANZ%3A%20L’usine%20de%20Natanz,connu%20des%20sites%20nucl%C3%A9aires%20iraniens.
Ici Beyrouth (2025), Les principaux sites connus du programme nucléaire iranien. Lien: https://icibeyrouth.com/articles/1318771/les-principaux-sites-connus-du-programme-nucleaire-iranien
Le Monde (2025), L’Iran ne renoncera pas à l’enrichissement d’uranium, «une question de fierté nationale», dit le ministre des affaires étrangères. Lien: https://www.lemonde.fr/international/article/2025/07/22/l-iran-ne-renoncera-pas-a-l-enrichissement-d-uranium-previent-le-ministre-des-affaires-etrangeres_6622880_3210.html
France Info (2025), Bombardements américains en Iran: « Les États-Unis sont allés au secours de la victoire israélienne ». Lien: https://www.franceinfo.fr/monde/conflit-israel-iran/bombardements-americains-en-iran-les-etats-unis-sont-alles-au-secours-de-la-victoire-israelienne-estime-le-geopolitologue-frederic-encel_7330170.html
Henderson Simon (2021), Policy Analysis – Iranian Nuclear Breakout: What It Is and How to Calculate It, The Washington Institute, Lien: https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/iranian-nuclear-breakout-what-it-and-how-calculate-it
Moritz Francis (2025), Israel–Iran, l’imbroglio nucléaire, The Times of Israel, lien: https://frblogs.timesofisrael.com/israel-iran-limbroglio-nucleaire/
Fayet Héloïse, Fayad Eli (2025), Conflit Iran/États-Unis: l’Iran a-t-il déjà perdu?, France Culture, lien: https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/questions-du-soir-le-debat/conflit-iran-etats-unis-l-iran-a-t-il-deja-perdu-6827618