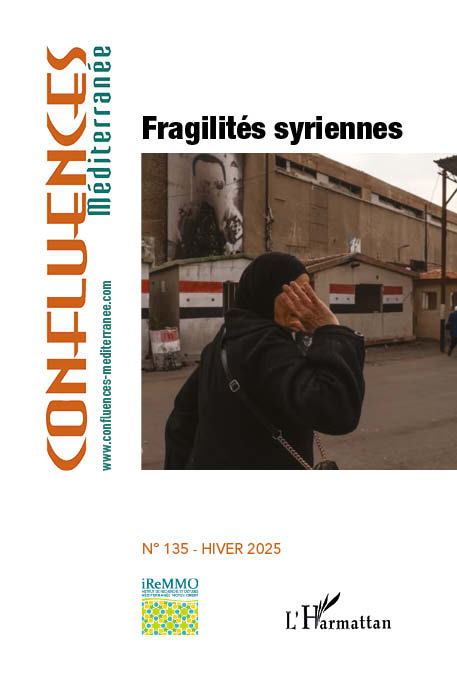Depuis la révolution islamique de 1979, l’Iran a connu une transformation démographique et éducative profonde. Alors que l’alphabétisation et l’enseignement supérieur se sont massivement développés, les revendications sociales et politiques se sont intensifiées. Mais dans quelle mesure ce progrès éducatif remet-il réellement en cause l’islam politique ?
L’année 1979 marque un tournant décisif pour l’Iran. Politiquement, la monarchie de Mohammad Reza Pahlavi est renversée, laissant place à un régime fondé sur l’islam politique. Démographiquement, c’est aussi la première fois que la majorité des Iraniens vivent en milieu urbain et que plus de la moitié de la population sait lire et écrire. Quarante-cinq ans plus tard, ce double bouleversement a façonné une société profondément transformée : aujourd’hui, moins de 10 % des Iraniens sont analphabètes, et près de 70 % vivent en ville[1].
Mais ce développement de l’instruction, loin de renforcer l’adhésion au régime, a contribué à l’émergence de nouvelles aspirations politiques et sociales. La jeunesse urbaine, connectée et diplômée, réclame davantage de libertés et rejette les normes imposées par les autorités religieuses. Pour autant, l’islam politique résiste, s’adapte et conserve les leviers du pouvoir.
Comment expliquer cette tension entre modernisation sociale et persistance du régime ? Le progrès éducatif en Iran a-t-il réellement affaibli l’islam politique, ou n’a-t-il fait qu’en déplacer les lignes ?
L’instruction, moteur de contestation
Depuis 1979, les autorités iraniennes ont fait de l’éducation une priorité stratégique. En misant sur l’alphabétisation de masse et le développement de l’enseignement supérieur, le régime espérait encadrer idéologiquement la jeunesse tout en modernisant le pays. Le résultat est saisissant : entre 2003 et 2008, le nombre d’étudiants est passé de 2,1 à 3,48 millions, et aujourd’hui, l’analphabétisme est devenu marginal.[2]
Ce progrès éducatif a particulièrement bénéficié aux femmes et aux minorités. En 2010, la parité était atteinte dans les universités publiques, avec même une majorité de femmes (56 %) dans certains établissements[3]. Les populations kurdes et baloutches ont aussi largement investi les bancs de l’université. Loin d’être un simple outil de formatage idéologique, l’université est devenue un espace d’ouverture, d’émancipation, voire de contestation.
Ce nouveau paysage social a vu émerger une classe moyenne urbaine, jeune, informée et critique. En 2009, des manifestations massives éclatent après l’élection controversée de Mahmoud Ahmadinejad. En 2019, c’est la hausse brutale du prix de l’essence qui provoque un soulèvement national. En 2022, la mort de Mahsa Amini, arrêtée par la police des mœurs pour non-port du voile, déclenche le mouvement “Femme, Vie, Liberté”, qui traverse le pays et attire l’attention internationale. L’Iran voit s’imposer, au fil des ans, une contestation qui puise dans les logiques mêmes que le régime avait contribué à développer : instruction, esprit critique, conscience politique.
Une société plus instruite, un régime toujours résilient
Malgré l’essor de l’instruction, les structures du pouvoir restent solidement enracinées. La majorité des Iraniens ayant grandi depuis la révolution n’ont connu que ce régime et n’envisagent pas nécessairement une rupture brutale. Le système institutionnel, quant à lui, continue d’être largement verrouillé par les conservateurs. En 2024, plus des deux tiers du Parlement sont contrôlés par la “Coalition des forces de la révolution islamique” et des groupes ultra-conservateurs comme “Peydari” ou le “Clergé combattant”.[4]
Le régime conserve également un contrôle étroit sur l’appareil éducatif. Certaines universités comme Imam Jafar Sadegh ou Imam Hoseyn sont explicitement destinées à former l’élite islamiste du pays. Ce maillage idéologique s’accompagne d’une répression ciblée contre les intellectuels et les penseurs critiques. Beaucoup sont poussés à l’exil, à l’image de la juriste et prix Nobel de la paix Shirin Ebadi. D’autres, comme Narges Mohammadi, militante des droits humains et aussi prix Nobel, sont emprisonnés.
Si les femmes sont de plus en plus nombreuses à obtenir des diplômes universitaires, à contrario leur intégration dans le monde professionnel reste très limitée. En 2023, elles ne représentent que 14,4 % de la population active, contre moins de 10 % en 1990.[5] Cette progression est loin de refléter leur niveau d’éducation. Le secteur public et les coopératives islamiques, principaux employeurs du pays, sont étroitement liés aux sphères conservatrices, ce qui riment souvent à une certaine réticence à l’embauche des femmes.
Enfin, la situation économique accentue les contradictions du système. Faute de débouchés, de nombreux diplômés quittent le pays, alimentant une fuite des cerveaux massive. Cette émigration, bien que préjudiciable à long terme pour l’économie nationale, permet paradoxalement de contenir la pression sociale en offrant une échappatoire aux élites critiques.
Le régime s’adapte : entre realpolitik et technocratie
Face aux protestations croissantes et à une société de plus en plus difficile à contrôler idéologiquement, le régime iranien a progressivement adopté une posture plus pragmatique. Pour surmonter les effets des sanctions internationales, Téhéran redéfinit sa politique étrangère. L’adhésion aux BRICS et la reprise du dialogue avec l’Arabie saoudite illustrent ce repositionnement stratégique. La confrontation avec Israël et les États-Unis reste centrale, mais elle s’inscrit désormais dans une logique de survie interne.
La diplomatie s’est imposée comme un instrument essentiel pour apaiser les tensions sociales. En améliorant les perspectives économiques à travers des accords régionaux et à travers des partenariats alternatifs, les autorités espèrent calmer les frustrations populaires. On observe également l’émergence d’une nouvelle génération de dirigeants plus technocrates, qui se soucient davantage de stabilité que d’idéologie.
Cette évolution vers une “realpolitik” à l’iranienne, ne signifie pas un abandon des fondements du régime, mais une adaptation face à une réalité sociale qui lui échappe de plus en plus. Plutôt que de renoncer à son modèle, il semble que le gouvernement cherche à en moduler la structure, en incorporant partiellement les attentes de modernité tout en préservant le contrôle politique et l’importance de la tradition.
L’instruction comme facteur de tension durable
Depuis 1979, le régime islamique iranien a produit une société paradoxale : plus instruite, plus connectée, plus critique – mais toujours soumise à un pouvoir religieux résilient. Si l’éducation a favorisé la mise en place du pouvoir, elle est aussi l’origine des contestations n’ayant pas encore abouti à de transformation majeure. Le régime continue de s’adapter, alternant entre répression et pragmatisme, contrôle idéologique et repositionnements diplomatiques.
Pourtant, les lignes bougent. Les tensions internes s’accumulent, les aspirations à la liberté se diversifient, et le clergé ne pourra indéfiniment ignorer la fracture entre le pays réel et ses institutions. La capacité du régime à concilier autorité religieuse et société moderne sera déterminante pour l’avenir politique de l’Iran.
De Dorian Petit
Bibliographie
Base de données et sources officielles
CurieXplore (2024), [Base de données] https://curiexplore.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pays/IRN
Direction générale du Trésor (s. d.), Indicateurs, conjoncture, brèves macroéconomiques et sectorielles – IRAN | Direction générale du Trésor. https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/IR/indicateurs-conjoncture-breves-macroeconomiques-et-sectorielles
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (s. d.), Présentation de l’Iran. France Diplomatie – Ministère de L’Europe et des Affaires étrangères.
World Bank Open Data (s. d.), World Bank Open Data. https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/presentation-de-l-iran/
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SE.ADT.LITR.ZS?locations=IR
Articles scientifiques
Adelkhah, F. (2013), Les Paradoxes de l’Iran: Idées reçues sur la République islamique. Le Cavalier Bleu. https://doi.org/10.3917/lcb.adelk.2013.01.
Balaÿ, C. (2017), La crise de la conscience iranienne: histoire de la prose persane moderne (1800-1980), L’Harmattan.
CNRI Femmes (2024, août 5), Rapport de juillet 2024: La participation économique des femmes en Iran. Commission des Femmes. https://wncri.org/fr/2024/08/03/participation-economique-des-femmes/
Hourcade, B. (2021, 28 octobre), Iran. Paradoxes d’une nation – Dossier 8143 – CNRS Editions. CNRS Editions. https://www.cnrseditions.fr/catalogue/geographie-territoires/iran/
Hourcade, B. (2025), L’Iran: Entre ambitions régionales et défis intérieurs après le 7 octobre. Eismena, 1(1), 11-20. https://shs.cairn.info/revue-eismena-2025-1-page-11?lang=fr.
Khosrokhavar, F. (2009), Avoir vingt ans au pays des ayatollahs. Robert Lafont, Paris https://doi.org/10.3917/rola.khosa.2009.01
Porter, Y. (2006), Les iraniens: Histoire d’un peuple. Armand Colin. https://doi.org/10.3917/arco.porte.2006.01
Notes
1) CurieXplore, “Iran, enseignement supérieur”
2) World Bank Open Data, “Taux d’alphabétisation, total des adultes (% des personnes âgées de 15 ans et plus)”
3) CurieXplore, “Iran, enseignement supérieur”
4) Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. France Diplomatie, “Présentation de l’Iran”
5) CNRI Femmes. Rapport de juillet 2024 : La participation économique des femmes en Iran.