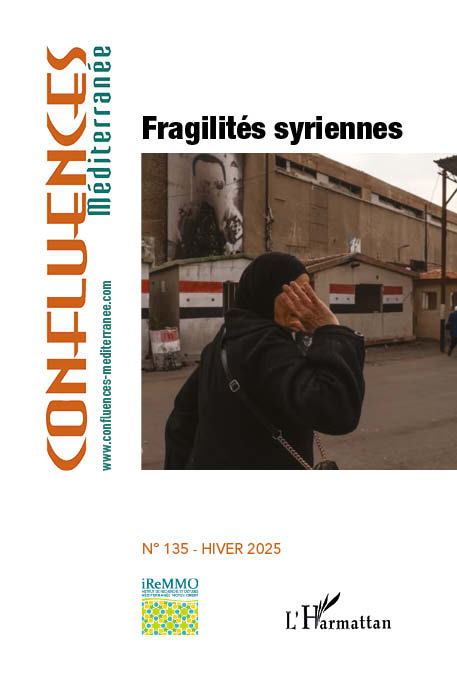Le 23 septembre 2025, Joe Saddi, ministre libanais de l’Énergie et de l’Eau, a signé un accord avec Joe Dakkak, directeur général de CMA CGM au Liban. L’accord prévoit la fourniture de 45MW à partir de trois fermes solaires[1]. Il remet au centre du débat la question de la production et de la souveraineté énergétique du pays.
La situation libanaise s’inscrit dans un contexte régional particulier. Le Moyen-Orient concentre 47,3 % des réserves mondiales de pétrole[2] et près de 40% des réserves mondiales de gaz naturel[3]. Cette abondance entretient une surconsommation d’hydrocarbures. La région est d’ailleurs la seule au monde où l’intensité énergétique, c’est-à-dire le rapport entre consommation et création de richesse, a augmenté au cours des quarante dernières années[4].
Le Liban fait figure d’exception. Ses ressources en hydrocarbures demeurent limitées, même si des gisements comme Cana ont été découverts ces dernières années[5]. Cette faiblesse contraint le pays à repenser sa stratégie énergétique. L’enjeu est à la fois économique et géopolitique. Pour comprendre les choix des responsables libanais, il faut d’abord analyser la crise économique et son impact sur l’énergie, puis observer les dynamiques politiques et individuelles données au secteur de l’énergie.
Depuis 2021, la crise économique s’est aggravée. Plusieurs facteurs se conjuguent : un endettement public massif, une dépendance aux devises étrangères, une crise de confiance envers le système bancaire. Les chocs extérieurs, pandémie de Covid-19 et guerre en Ukraine, n’ont fait qu’accentuer cela. L’ensemble a provoqué une dépréciation de la livre libanaise de près de 98 % depuis 2019[6]. Cette chute a entraîné une inflation galopante et une forte baisse du pouvoir d’achat. Le pays ne parvient plus à s’approvisionner correctement à l’international ni à maintenir une production industrielle. Cela provoque une crise énergétique dans le secteur de l’industrie mais aussi pour les particuliers. La crise économique a donc ravivé la question énergétique.
Les principaux secteurs de consommation d’énergie au Liban sont le transport, l’industrie et le résidentiel. Entre 2017 et 2022, la consommation électrique est passée de 19468 GWh à 3948 GWh[7], soit une baisse de près de 89 %. Cette chute ne traduit pas une volonté de sobriété, mais bien l’incapacité du gouvernement à réformer le secteur et à assurer l’approvisionnement. Depuis 2022 la consommation n’a pas grandement évolué
Cette incapacité a favorisé l’émergence d’acteurs privés, renommés la «mafia des générateurs[8]». Ils fournissent illégalement de l’énergie aux ménages. L’entreprise publique Électricité du Liban n’ayant plus les moyens d’assurer le service, ce système parallèle s’est imposé. Cela aggrave la précarité des foyers.
La dépendance est aussi extérieure. Le Liban doit compter sur l’aide énergétique de ses partenaires régionaux. Le 23 août 2025, le Koweït a livré 132000 tonnes de gasoil pour alimenter les centrales d’Électricité du Liban. La moitié de cette cargaison constituait un don, l’autre moitié était vendue à prix réduit[9]. Mais ce geste humanitaire est aussi un levier diplomatique. Les relations entre le Liban et le Koweït ont souvent été tendues, en particulier sur la question de l’influence iranienne au Liban et sur la guerre au Yémen. Fournir du carburant devient un instrument d’influence régionale pour le Koweït.
La crise économique a donc provoqué une crise énergétique. Elle a rendu les Libanais dépendants de réseaux privés illégaux, mais aussi des livraisons de pays tiers. Pour tenter de s’en affranchir, l’État se tourne désormais vers des accords régionaux ou internationaux capables de lui garantir l’approvisionnement nécessaire à ses habitants et à la relance de son économie.
La relance industrielle dépend directement de la capacité à fournir de l’électricité. Selon certains travaux, la croissance économique est liée à la croissance de sa consommation énergétique. L’économiste Gaël Giraud parle d’élasticité du PIB[10]. D’où les volontés politiques libanaises de relancer la croissance de la consommation en adaptant l’offre. Le développement de la production énergétique dans le secteur industriel doit permettre de produire à une échelle locale et d’être moins dépendant des importations. Pour les dirigeants, l’indépendance énergétique doit garantir qu’une crise comme celle de 2021-2022 ne se reproduise plus. Cela passe par l’exploitation des gisements découverts. Cana, à cet égard, est un exemple parlant. Un accord a été signé en 2022 pour l’exploitation de ce champ gazier avec Israël. En vertu de cet accord, le Liban dispose de tous les droits d’exploration et d’exploitation, mais les analystes s’accordent à dire qu’il faudra encore plusieurs années avant d’entrer dans la phase de production[11]. Aujourd’hui, son exploitation n’a toujours pas commencé. Ces futures productions doivent pourtant se substituer, en partie, aux importations et assurer une souveraineté énergétique durable au pays.
Cependant, le réchauffement climatique touche deux fois plus le Moyen-Orient que le reste du monde[12]. Dans ce contexte, ajouter des énergies renouvelables au mix énergétique présente un triple intérêt : décarboner l’économie, rendre viable la vie au Liban à moyen et long terme, et favoriser une autonomie vis-à-vis des puissances exportatrices d’hydrocarbures. Cet objectif national repose sur deux piliers : la géothermie et le solaire. Le Liban s’est fixé un projet de 5 GW en énergies renouvelables, dont 2 GW en solaire et 3,5 GW en géothermie à horizon 2025[13]. Pour le solaire, deux options existent : les toitures photovoltaïques et les fermes solaires. Le potentiel solaire du Liban est estimé à 28,1 TWh/an[14], soit environ deux fois la consommation nationale de 2019, c’est-à-dire avant la crise économique. Le solaire représente donc un enjeu aussi bien pour les particuliers, qui installent des panneaux afin de réduire leurs dépenses, que pour les entreprises, qui y voient un levier de production.
Dans ce cadre, le gouvernement libanais a émis 11 licences pour créer des fermes solaires sur le territoire en 2022. La société sœur de CMA CGM, Merit Invest, avait obtenu trois licences pour construire des fermes d’une capacité de 15 MW chacune. L’accord du 24 septembre 2025 correspond à 45 MW[15]. Mais il illustre aussi la lenteur du processus: le gouvernement a dû relancer les détenteurs de licences, souvent hésitants à investir en raison de l’instabilité locale. Même si ces projets visent à renforcer l’autonomie énergétique, ils posent une autre question : la supply chain des panneaux solaires reste à près de 80 % dominée par la Chine[16]. Cela interroge sur le risque de substitution d’une dépendance énergétique régionale à une dépendance indirecte vis-à-vis des matériaux importés.
Le Liban constitue un cas intéressant par sa situation énergétique dans la région. Le pays a traversé une grave crise économique qui a entraîné une crise énergétique majeure. Cette crise a révélé l’incapacité des pouvoirs publics et a accentué la précarité de la population. Les responsables politiques sont toutefois conscients de ces difficultés: ils tentent d’y répondre à court terme en assurant l’approvisionnement grâce à des acteurs régionaux, tout en cherchant à relancer, à moyen et long terme, la production nationale et à accroître la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique.
Il reste néanmoins essentiel pour le Liban de garder à l’esprit la question de l’autonomie énergétique: la dépendance vis-à-vis des moyens de production peut toujours perdurer. D’autre part, l’exploitation de ressources comme le champ de Cana demeure étroitement liée au contexte géopolitique, et en particulier par les relations du Liban avec Israël. Le futur énergétique du Liban se joue autant sur son sol qu’à l’international.
Notes
[1] «Le ministère de l’Énergie signe des contrats d’achat d’électricité solaire avec CMA CGM», L’Orient-Le Jour, 23 septembre 2025, [en ligne], consulté le 2 octobre 2025.
[2] «Réserves et production de pétrole dans le monde», Connaissance des Énergies, dernière modification le 27 juin 2024, d’après Energy Institute, Statistical Review of World Energy (2023), [en ligne], consulté le 2 octobre 2025.
[3] «Classement des États du monde par réserves prouvées de gaz naturel», Atlasocio.com, mis à jour le 27 septembre 2019, [en ligne, consulté le 2 octobre 2025].
[4] FAVENNEC, Jean-Pierre, Géopolitique et transition énergétique, Paris, Technip, 2ᵉ éd., 2019, p. 191.
[5] «Israël et le Liban concluent un accord historique sur leur frontière maritime», Le Monde, 11 octobre 2022, [en ligne], consulté le 2 octobre 2025.
[6] «Au Liban, un dollar vaut désormais 100000 livres, un record historique», Euronews, 14 mars 2023, [en ligne, consulté le 2 octobre 2025].
[7] «Consommation d’électricité au Liban», CountryEconomy.com, dernière mise à jour non précisée, d’après données statistiques de CountryEconomy, [en ligne], consulté le 2 octobre 2025.
[8] SALLON, Hélène, «Les Libanais à la merci de la “mafia des générateurs”», Le Monde, publié le 22 février 2022, modifié le 23 mai 2022, [en ligne], consulté le 2 octobre 2025.
[9] «Le Liban reçoit sa première cargaison de carburant koweïtien dans le cadre d’un accord d’aide énergétique», L’Orient-Le Jour, 23 août 2025, [en ligne, consulté le 2 octobre 2025].
[10] CLICHE, Yvan, Jusqu’à plus soif: pétrole, gaz, éolien, solaire. Enjeux et conflits énergétiques, Montréal, Fides, 2022.
[11] «TotalEnergies: un accord-cadre avec Israël sur le champ gazier partagé avec le Liban», Connaissances des Énergies (AFP), 15 novembre 2022, [en ligne, consulté le 2 octobre 2025].
[12] ATLANTIC COUNCIL, An Energy and Sustainability Roadmap for the Middle East, février 2025, [en ligne, consulté le 2 octobre 2025].
[13] «Joseph Saddi nommé ministre de l’Énergie au Liban: défis et priorités», Energynews.pro, publié le 8 février 2025, [en ligne, consulté le 2 octobre 2025].
[14] Hasan Nasrallah, Abed Ellatif Samhat, Yilei Shi, Xiaoxiang Zhu, Ghaleb Faour et Ali J. Ghandour, Lebanon Solar Rooftop Potential Assessment using Buildings Segmentation from Aerial Images, Université Américaine de Beyrouth (AUB), rapport scientifique, 2021, arXiv:2111.11397 [cs.CV], [en ligne]: https://doi.org/10.48550/arXiv.2111.11397, consulté le 2 octobre 2025.
[15] Op. cit. L’Orient-Le Jour, 23 septembre 2025, [en ligne], consulté le 2 octobre 2025.
[16] ATLANTIC COUNCIL, An Energy and Sustainability Roadmap for the Middle East, février 2025, [en ligne, consulté le 2 octobre 2025].