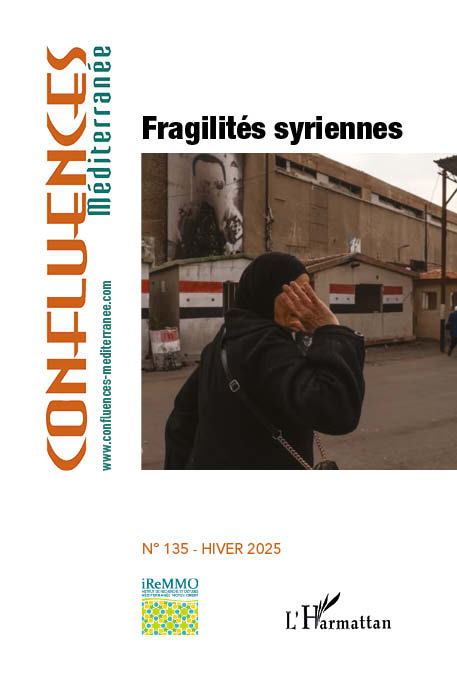Au cours des deux dernières décennies, l’Union européenne a opéré une large diversification de ses interventions en direction des pays du Maghreb et plus spécifiquement du Maroc et de la Tunisie, l’Algérie, la Mauritanie et la Libye restant en retrait. Bien que son rôle ne soit pas toujours apparent, l’UE apporte une contribution implicite, mais croissante à la configuration sur le long terme des espaces qui la bordent sur les rives sud de la Méditerranée et à celle de l’Afrique du nord-ouest. Cette contribution sera prochainement redéfinie en fonction de ce que proposera la Commission en 2015, quant à la révision de la politique européenne de voisinage (PEV).
Les interventions communautaires fonctionnent suivant une logique très « européocentrique », particulièrement affirmée dans la PEV du fait de sa parenté avec la négociation d’adhésion. D’une part, la politique européenne est la projection des acquis internes (là où il existe une compétence communautaire) sur les pays tiers. D’autre part, l’approche « à la carte » implique la digestion d’une bonne partie des 90000 pages du journal officiel UE, ce qui pose des problèmes d’adaptabilité et de gestion aux administrations des pays du voisinage chargées de les appliquer. Il en résulte une capacité de mise en œuvre inégale : dans les documents de stratégie, les pays du Maghreb prennent un assez grand nombre d’engagements, dont la concrétisation se fait parfois attendre.
Télécharger le document : Le Maghreb et l’Union européenne
Table des matières
Introduction
Rappel chronologique
- Les accords d’association initiaux (1969-1995)
- Barcelone et la dynamique EUROMED (1995-2004)
- Depuis 2004, la politique européenne de voisinage (PEV)
- Synthèse des accords
Géopolitique de la coopération
- Le Maghreb vu de Bruxelles
- Des États membres inégalement motivés
- Le Maghreb est-il avantagé par son appartenance au groupe des PSEM ?
- La faiblesse de la coopération intermaghrébine
- Perspectives
- Quelles alternatives ?
Thématique de la coopération
- La logique économique
- Le volume des échanges Maghreb-UE
- Le régime des échanges
- L’intégration dans le marché unique
- La logique territoriale
- L’environnement
- Les transports
- La coopération transfrontalière et transnationale
- La politique maritime intégrée
- La logique sécuritaire
- Les questions migratoires
- La lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée
- Le Maghreb et la politique étrangère européenne
- L’UE et le conflit du Sahara occidental
- Les divergences
- Le Forum ouest-méditerranéen (dialogue 5+5)
- Orientations futures
- Les instruments financiers
Trois questions transversales
- La dépendance énergétique
- La montée en puissance des dimensions atlantique et saharienne
- Le déficit démocratique