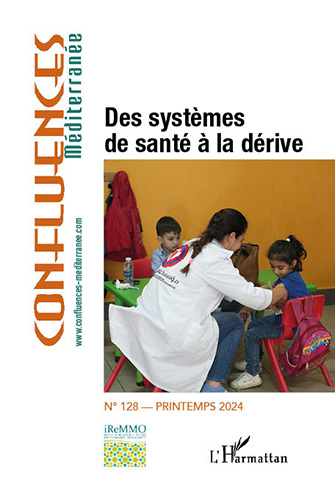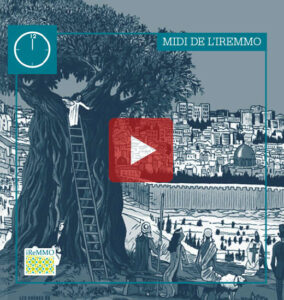Du 21 mars au 23 mai | 18h30-20h30 (tous les mardis)
Les formations peuvent être suivies soit en ligne, soit en présentiel dans les locaux de l’iReMMO.
En cas de conflit sur les règles communes d’une cité donnée, entre un représentant de l’autorité politique et un représentant de l’autorité religieuse, qui a eu le dernier mot? Les droits affectés aux personnes individuelles ont-ils ou non primé les droits affectés à des groupes identifiés par un lien religieux? La finalité de l’État a-t-elle été de garantir les droits politiques et sociaux?
Ces trois questions seront au cœur des interventions du séminaire. La mise en perspective historique se veut résolument comparatiste, elle inclut les religions comme les idéologies séculières. Elle prend en compte les relations diplomatiques, militaires et culturelles et englobe les cadres coloniaux, sans s’y réduire. Elle permet de placer en exergue le commun des défis liés à la construction de l’État moderne, et le propre des réponses, comme de leur temporalité, en fonction des acteurs et de leur localisation.
Responsable du séminaire
Professeure d’histoire contemporaine et relations internationales à l’Université d’Aix-Marseille. Elle s’intéresse à l’impact du religieux dans la législation et la vie politique contemporaine, notamment en France et aux États-Unis. Elle est coautrice avec Valentine Zuber et Roland Dubertrand d’un ouvrage de synthèse intitulé Géopolitique des religions: un nouveau rôle du religieux dans les relations internationales (Cavalier Bleu, 2019).
Diplomate, agrégé d’arabe, ingénieur, docteur en islamologie et chercheur associé au « Groupe d’études orientales, slaves et néo-helléniques » de l’Université de Strasbourg. Après une carrière dans le privé, il a servi, au sein du ministère français des Affaires étrangères, successivement en Iraq (2005-2006), au Soudan (2008-2012) et en Oman (2012-2016). Représentant permanent adjoint de la France auprès du Conseil de l’Europe à Strasbourg (France) entre 2016 et 2018, il a été sous-directeur d’Afrique entre 2018 et 2022. Il enseigne actuellement l’arabe dans un collège à Courbevoie et à l’Université de Lorraine.
Titulaire d’un doctorat en histoire contemporaine de l’Université du Mans (France), il est spécialiste en histoire des idées dans l’espace arabo-méditerranéen. Professeur assistant à l’Université libanaise (Liban), il enseigne l’histoire, la philosophie et des cours en lien avec le politique et la citoyenneté.
Il a publié plusieurs livres en arabe et en français, entre autres Gamal al-Banna : l’islam, la laïcité et la liberté (avec D. Avon, l’Harmattan, 2013), Musulmans et laïcités (Peter Lang, 2014), Almâniyya min ‘indina (« Laïcité de chez nous »), (Dar saer el-Machrek, 2017), Lubnân bi qalam moufakiri al-nadwa al-lubnaniyya (« Le Liban comme l’écrivent les penseurs du Cénacle libanais »), (Université Saint-Esprit de Kaslik, 2012).
Historien du Maghreb contemporain, Augustin Jomier est maître de conférences au département d’études arabes de l’Inalco et chercheur au Cermom. Il est l’auteur du livre Islam, réforme et colonisation : une histoire de l’ibadisme en Algérie (1882-1962) (Sorbonne, 2020). Il a coanimé de 2016 à 2020 à l’EHESS un projet collectif sur l’histoire de l’orientalisme savant en Algérie coloniale, dont sortira bientôt un livre, L’orientalisme en train de se faire (EHESS, 2023). Le chantier principal auquel il s’attèle à présent porte sur l’histoire sociale, culturelle et politique des bibliothèques au Maghreb (XIX-XXe siècle).
Professeur en histoire contemporaine à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Rattaché à l’UMR-Sirice (Sorbonne Identités, relations internationales et civilisations de l’Europe), il enseigne l’histoire de l’Amérique du Nord, l’histoire des relations internationales et l’histoire des religions et de la sécularisation. Il a publié notamment La pensée catholique en Amérique du Nord (DDB, 2010), Traduire la liturgie (CLD, 2013), Diplomatie et religion (Sorbonne, 2016), Étienne Gilson. Une biographie intellectuelle et politique (Vrin, 2018). Il a codirigé, avec Yann Raison du Cleuziou, le volume À la droite du Père. Les catholiques et les droites en France depuis 1945 (Seuil, 2022). Il a dirigé également l’édition des deux premiers tomes des Œuvres complètes d’Etienne Gilson (Vrin, 2019, 2023).
Titulaire d’une licence en langue et littérature arabes de l’université « Ca’ Foscari » de Venise et d’un diplôme de l’Institut pontifical d’études arabes et islamiques (Pisai) de Rome. De 2001 à 2011, elle a enseigné la médiation linguistique arabe-italien (écrit et oral) à l’Université « Unint » de Rome. De 2004 à 2018, elle a travaillé comme traductrice de l’arabe, de l’anglais et du français vers l’italien, en collaborant avec des agences de presse et des maisons d’édition. En 2018, elle a repris ses études dans le cadre d’un doctorat à l’Institut italien d’études orientales (ISO) – Sapienza Université de Rome en cotutelle avec l’École pratique des hautes études (EPHE) de Paris, obtenant son diplôme en 2022 avec une thèse sur la pensée non violente du théologien et prédicateur syrien Ǧawdat Saʿīd (« La non-violence comme moyen de changement en islam : la contribution de Ǧawdat Saʿīd »). Elle est membre du Groupe de recherche arabo-chrétien (Grac) depuis 1995. Ses principaux intérêts de recherche sont la pensée islamique contemporaine dans une perspective d’histoire des idées, l’herméneutique coranique contemporaine et la littérature médiévale arabe-chrétienne.
Chercheur associé au Centre de recherche français à Jérusalem (CRFJ). Historien des relations germano-israéliennes, de 1945 à nos jours, et des présences européennes, notamment françaises et allemandes sous leurs aspects catholiques en Palestine (1850-1948) et en Israël, il est l’auteur de nombreux articles et de plusieurs ouvrages sur ces sujets, dont : De la Shoah à la réconciliation? La question des relations RFA-Israël (1949- 1956) (CNRS, 2000), De Bonaparte à Balfour. La France, l’Europe occidentale et la Palestine, 1799–1917 (dir., avec Ran Aaronsohn, CNRS, 2001, 2e edition: 2008), De Balfour à Ben Gourion. Les puissances européennes et la Palestine, 1917-1948 (dir., avec Ran Aaronsohn, CNRS, 2008).
Maître de conférences à l’université du Mans. Ses recherches au sein de Temos (UMR 9016) portent sur plusieurs thèmes : l’histoire du judaïsme: Les femmes juives dans le sionisme politique (1897-1921). Féministes et nationalistes?, (Paris, Honoré Champion, coll. «Bibliothèque des études juives», 2018), Judaïsmes européens. Laboratoires des identités partagées (1770’s-1930’s) [ENG-Sub]; la question des minorités (codirection des ouvrages L’Histoire des minorités est-elle une histoire marginale ? (Paris, Pups, 2008) et Religions et Frontières (Paris, CNRS Éditions, 2012) et l’histoire de la pensée raciale (corédaction du Dictionnaire des racismes, de l’exclusion et des discriminations (Paris, Larousse, 2010). Il s’intéresse désormais au rapport des religions à la question raciale, objet du présent programme de recherche. Il est également codirecteur de l’Ipra (Institut du pluralisme religieux et de l’athéisme) et membre associé au GSRL (Groupe sociétés religions laïcités – UMR 8582 EPHE/CNRS).
Peut-on parler de géopolitique religieuse en Méditerranée - Séance 1 - 21 mars
Avec Blandine Chelini-Pont
L’islam comme religion d’État en Algérie - Séance 2 - 28 mars
Avec Augustin Jomier
Ligue islamique mondiale, Isesco et soft power - Séance 3 - 4 avril
Avec Sahra Ghozi
Un 3e Temple en Israël ? Les mouvements haredi dans le sionisme et au sein de l’État - Séance 5 - 18 avril
Avec Vincent Vilmain
Liban : système confessionnel vs aspirations laïques - Séance 5 - 25 avril
avec Amin Elias (en ligne)
Religion et diplomaties : le cas de la France et de l’Allemagne envers la Palestine et Israël - Séance 6 - 2 mai
avec Dominique Trimbur
Les catholiques francophones et le dépassement du “modèle constantinien” - Séance 7 - 9 mai
Avec Florian Michel
Le Groupe Etat islamique - Séance 8 - 16 mai
avec Othman El Kachtoul
De quoi le “régime islamique” est-il le nom ? - Séance 9 - 23 mai
Avec Dominique Avon
La Syrie des Assad et les élites religieuses - Séance 10 - 30 mai
avec Paola Pizzi
Ouvertes à tous et ne nécessitant pas de connaissances préalables, ces formations s’adressent à celles et ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance de la région. Elles peuvent être prises en compte dans le plan de formation de votre institution ou organisme de rattachement et donnent lieu, en fin de cycle, à la remise d’une attestation de formation professionnelle, sous la forme d’un certificat de spécialisation.
Reposant sur l’échange entre formateurs et participants, les formations de l’iReMMO réunissent des effectifs limités et se composent d’exposés associés à des temps de discussions collectives permettant l’approfondissement des thématiques abordées. Elles se déroulent à la fois en ligne et au siège de l’iReMMO, au 7 rue des Carmes, dans le 5e arrondissement de Paris (Métro Maubert-Mutualité).
Les + de nos séminaires
- En ligne et en présentiel
- Séances disponibles en replay
- Remise d’une attestation de formation professionnelle
- Des intervenant.e.s de haut niveau
- Aucun prérequis nécessaire
- Possibilité de payer en trois fois
Informations administratives
Pour plus d’informations, contactez formation-continue@iremmo.org
Tél: 01 42 01 31 43